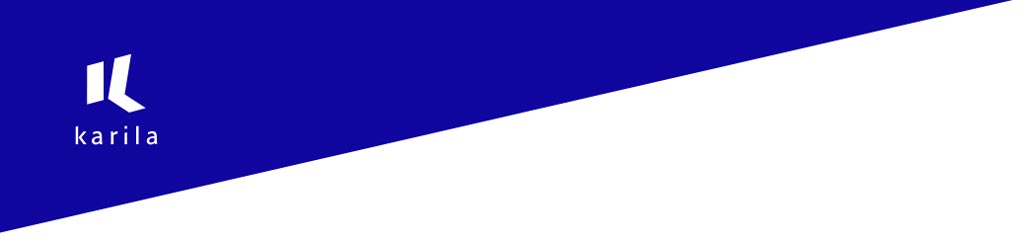Recueil Dalloz 1990 p.307 – Jean-Pierre Karila
Introduction
I. Garanties légales sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 4 janv. 1978 et responsabilité contractuelle de droit commun en marge du domaine d’application de ces textes.
A. – GARANTIES LEGALES.
B. – LA JUSTIFICATION DU RECOURS A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN.
- – Les applications classiques et traditionnelles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- – Les applications remarquées ou nouvelles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- – L’application et l’éviction de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre des défauts de conformité.
II. – Garanties légales sous l’empire de la loi du 4 janv. 1978 et responsabilité contractuelle de droit commun en marge du domaine d’application de cette loi.
A. – GARANTIES LEGALES.
B. – LES APPLICATIONS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN EN MARGE DES GARANTIES LEGALES. Les solutions transposables.
Les solutions nouvelles ou faisant difficulté.
III. – Le problème particulier du dol ou de la faute « extérieure au contrat », responsabilité délictuelle ou contractuelle de droit commun ?
IV. – Le problème irritant de la transmissibilité de l’action contractuelle de droit commun.
A. – LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE AU MAITRE D’OUVRAGE IMMOBILIER DE L’ACTION CONTRACTUELLE DEDROIT COMMUN DE L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL A L’EGARD DU SOUS-TRAITANT.
B. – LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE A L’ACQUEREUR DE L’ACTION CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN DUMAITRE DE L’OUVRAGE A L’EGARD DES LOCATEURS D’OUVRAGE.
C. – LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE AU LOCATAIRE DES GARANTIES LEGALES ET DE L’ACTION CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN.
Conclusion.
Introduction
Il y a maintenant plus d’une décennie que Mme Joëlle Fossereau, dans une chronique célèbre « Le clair-obscur de la responsabilité des constructeurs », mettait en relief les certitudes et les incertitudes des diverses garanties et responsabilités de cette catégorie de professionnels que sont les locateurs d’ouvrage immobiliers.
L’évolution a été, depuis, considérable.
D’abord, sur le plan légal, par l’intervention de la loi du 4 janv. 1978 qui :
- a accentué le caractère légal des garanties spécifiques dont sont redevables les locateurs d’ouvrages immobiliersaux termes de l’art. 1792 nouveau c. civ., complété par les articles nouveaux 1792-1 à 1792-6 du même code,
- et a considérablement élargi le domaine de celles-ci.
Ensuite, sur le plan jurisprudentiel, par :
- la création prétorienne d’une responsabilité dite « contractuelle de droit commun » pour les dommages qualifiés d’«intermédiaires », jurisprudence qui s’est développée en marge des garanties légales telles qu’elles résultent du code civil d’origine de 1804 ou/et encore essentiellement de la loi du 3 janv. 1967,
- l’élargissement considérable du domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun par :
- l’admission dans la chaîne de contrats homogènes, comme le sont des ventes successives, d’une action directe «nécessairement contractuelle » du sous-acquéreur à l’encontre d’un fabricant-vendeur initial ou du vendeur intermédiaire pour la garantie des vices cachés affectant dès sa fabrication la chose vendue (1), puis à l’encontre du vendeur initial (2) ou du vendeur intermédiaire (3) pour l’action rédhibitoire.
- l’admission dans la chaîne de contrats hétérogènes, comme le sont des ventes interrompues par un contrat d’entreprise, d’une action directe au profit du maître d’ouvrage immobilier à l’encontre du vendeur et/ou du fabricant de matériaux de construction par suite des arrêts de l’Assemblée plénière du 7 févr. 1986 qui, ce faisant, éludent complètement la garantie des vices cachés de l’art. 1641 c. civ. et son corollaire nécessaire, l’action à bref délai de l’article 1648 du même code.
- l’admission par la 1re Chambre civile, dans deux arrêts remarqués des 8 mars et 21 juin 1988, d’une action directe « nécessairement contractuelle » du maître d’ouvrage mobilier à l’encontre du sous-traitant et la transposition de cette solution par un certain nombre de cours d’appel en matière immobilière.
- la résistance remarquée de la 3e Chambre civile qui, notamment : a) refuse toute transmission de l’action contractuelle de droit commun du contrat d’entreprise du maître d’ouvrage immobilier au profit de l’acquéreur, alors que, depuis un arrêt du 23 mars 1968 (4), elle avait admis, comme l’avait déjà fait quelques mois auparavant la 1re Chambre civile (5), la transmission des garanties légales spécifiques issues des art. 1792 et 2270 c. civ. ; b) persiste, à juste titre selon nous, en l’état des textes actuels, à considérer que l’action du maître d’ouvrage immobilier à l’encontre du sous-traitant est de nature nécessairement délictuelle.
- les « repères » précis donnés récemment par la Cour suprême sinon stricto sensu quant aux domaines respectifsdes garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrages, du moins quant aux possibilités d’action du maître d’ouvrage lorsque les dommages revêtent les caractéristiques de ceux relevant des garanties légales (arrêts des 13 avr. 1988, 25 janv. 1989 et 4 oct. 1989).
- l’état actuel de la jurisprudence en matière de garantie de parfait achèvement instituée par la loi du 4 janv. 1978 (art. 1792-6 c. civ.), qui peut laisser penser que cette garantie absorberait la responsabilité contractuelle de droit commun en ce qui concerne, du moins, les dommages apparus pendant son délai d’exercice (arrêts des 19 avr. 1989 et 3 mai 1989).
L’accentuation du caractère légal des diverses garanties et responsabilités instituées ou organisées par la loi du 4 janv. 1978 n’est pas étrangère à l’évolution jurisprudentielle ci-dessus évoquée, tandis que le fait que le soustraitant ne soit pas tenu à ces garanties et responsabilités ne peut que compliquer la situation et qu’empêcher, à notre avis, une unité – impossible en l’état – mais souhaitable de la jurisprudence.
Le « clair-obscur » des responsabilités des constructeurs est peut-être aujourd’hui encore plus « clair » et encore plus « obscur » qu’au temps où il a été mis en évidence.
Aussi, nous est-il apparu nécessaire de faire le point sur les garanties légales et la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage immobiliers et de donner ici et là notre avis et, lorsque cela nous semble opportun, de formuler des propositions.
Une telle entreprise implique, si l’on veut être didactique, le rappel de solutions déjà tranchées et admises avant même d’aborder les questions les plus controversées.
I. – Garanties légales sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 4 janvier 1978 et responsabilité contractuelle de droit commun en marge du domaine d’application de ces textes.
A. – GARANTIES LEGALES.
On ne distinguera pas les garanties légales du code civil dans sa rédaction d’origine de 1804 de celles résultant de la loi du 3 janv. 1967.
Globalement, les garanties sont identiques, sous cette réserve que la loi du 3 janvier 1967 institue la garantie biennale pour les menus ouvrages ignorée du code civil d’origine.
Les garanties légales découlent des art. 1792 et 2270 c. civ. qui définissent notamment leur champ d’application, leur objet et leur durée.
Aux termes de l’art. 1792, les architectes et entrepreneurs (rédaction de 1804) puis les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (rédaction de 1967), sont responsables, pendant dix ans, de la perte « en tout ou partie » de « l’édifice », d’abord s’il est « construit à prix fait » (rédaction de 1804), puis quelle que soit la nature du marché (rédaction de 1967) par suite du « vice de la construction » même par suite du « vice du sol ».
Suivant l’art. 2270 c. civ., les architectes et entrepreneurs (rédaction de 1804), puis les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (rédaction de 1967) sont, après dix ans, « déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés » (rédaction de 1804), puis « déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages » (rédaction de 1967).
On sait que la loi n’a pas défini la notion d’édifice, comme celle de gros ouvrages et de menus ouvrages, tandis qu’un décret du 22 déc. 1967, pris pour la seule application des bâtiments à usage d’habitation ou de caractéristiques similaires, a donné, dans ses art. 11 et 12, une liste non limitative des gros et menus ouvrages et décidé, par ailleurs, dans son art. 13, que les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils lui sont livrés ne sont pas considérés comme ouvrages au sens de la loi.
Sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 4 janv. 1978, la mise en oeuvre des garanties légales suppose que le vice de construction et/ou encore sa conséquence ou manifestation, c’est-à-dire le désordre (la pratique judiciaire confondant d’ailleurs cause et conséquence) :
- ait été clandestin lors de la réception des travaux,
- ait son siège dans un ouvrage relevant de la loi, c’est-à-dire soit dans un gros ouvrage, auquel cas la garantie décennale est applicable, soit dans un menu ouvrage, auquel cas la garantie biennale est applicable, étant observé que les désordres affectant des menus ouvrages ressortissent cependant à la garantie décennale si le vice de construction auquel ils sont imputables a son siège dans de gros ouvrages (6).
- présente – mais seulement pour l’application de la garantie décennale – une certaine gravité, cette condition étant appréciée au regard des conséquences du désordre qui doit, soit porter atteinte à la solidité de l’immeuble, soit rendre celui-ci impropre à sa destination, étant cependant précisé que la condition de gravité des désordres a connu une éclipse temporaire, la Cour suprême s’étant contentée, pendant une certaine période, de la seule localisation des désordres dans un gros ouvrage (7) pour y revenir, depuis un arrêt de principe du 9 déc. 1970 (8), et s’y tenir depuis de façon constante (9).
Cette présentation schématique doit être complétée par les précisions suivantes :
- le caractère ponctuel d’un désordre n’est pas exclusif de la condition de gravité de celui-ci : un désordre unique etponctuel peut relever de l’art. 1792 c. civ. (10), tandis que la multiplicité des désordres peu importants n’implique pas, en revanche, l’existence de la condition de gravité et par voie de conséquence l’application de la garantie décennale (11).
- la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative a tendance à considérer que les désordres constituant un dangerpour la sécurité des personnes relèvent de la garantie décennale.
- la distinction des gros et menus ouvrages, constituant la ligne de partage entre les domaines respectifs de lagarantie décennale et de la garantie biennale, est quelquefois volontairement « gommée », « ignorée » ou encore « court-circuitée » de façon artificielle par les juges du fond au prétexte d’impropriété à la destination, notion relevant de leur seul pouvoir d’appréciation (12).
Les juridictions de l’ordre administratif adoptent les mêmes solutions en appliquant les principes dont « s’inspirent » les art. 1792 et 2270 c. civ. sous réserve des différences ci-après :
- sans ignorer la garantie biennale des menus ouvrages retenue pour la première fois le 17 déc. 1980 (13), les juridictions administratives ne se réfèrent, de fait, à la garantie biennale que si, à propos des dommages affectant les menus ouvrages, les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale ne se trouvent pas réunies (14).
- le Conseil d’Etat est plus strict, semble-t-il, que la Cour suprême quant à la condition de gravité lorsqu’il s’agitd’apprécier la notion d’impropriété à la destination (15).
- le Conseil d’Etat manifeste sa volonté de limiter l’objet de la garantie décennale aux désordres graves et importants dont le coût de réparation est élevé (16) et ce, quand bien même la condition d’impropriété à la destination serait remplie (17).
La jurisprudence tant judiciaire qu’administrative sanctionne la garantie biennale par application de l’art. 2270 c. civ. et la responsabilité décennale par application des art. 1792 et 2270 du même code.
Cette absence d’autonomie des art. 1792 et 2270 à propos de la responsabilité décennale nous semble vérifiée en jurisprudence.
Il est inexact que l’art. 1792 ait été le seul texte d’application de la garantie décennale tandis que l’art. 2270 n’aurait été que celui de l’application de la garantie biennale et/ou encore de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Quoi qu’on en ait dit, les art. 1792 et 2270 n’ont jamais eu – tant sous l’empire du code civil de 1804 que sous l’empire de la loi du 3 janv. 1967 – aucune autonomie l’un par rapport à l’autre au regard de leurs champs d’application respectifs comme au regard de la nature de la responsabilité qu’ils aménagent.
La jurisprudence n’a jamais, en effet, clairement distingué la notion d’édifice de celle de gros ouvrage, ni expressément décidé que la garantie décennale n’était applicable qu’au seul cas de perte partielle ou totale d’un édifice, tandis que les dommages atteignant les gros ouvrages, qu’ils fassent ou non partie d’un édifice, relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Tout au plus rencontre-t-on certaines décisions isolées sous l’empire du code civil d’origine et qui, suivant la doctrine de MM. Aubry et Rau, distinguaient les deux textes à propos seulement du régime de la responsabilité de garantie décennale (présomption de faute et/ou présomption de responsabilité pour l’art. 1792, faute prouvée pour l’art. 2270 selon que le marché de l’entrepreneur a été ou non à forfait) ; aucune de ces décisions isolées n’a indiqué clairement que la responsabilité ou la garantie décennale n’était régie que par l’art. 1792 c. civ., tandis que l’art. 2270 du même code n’aurait été qu’un texte d’application de la responsabilité contractuelle de droit commun au cas particulier de la construction des seuls gros ouvrages.
Traditionnellement d’ailleurs, les arrêts sanctionnant la responsabilité ou la garantie décennale visaient à la fois les art. 1792 et 2270 c. civ.
En d’autres termes, l’art. 2270 n’était pas invoqué pour évincer la responsabilité décennale, mais seulement pour définir, au cas particulier, le régime de celle-ci.
Cela explique, sans doute, que la jurisprudence n’ait jamais clairement affirmé, avant l’intervention de la loi du 4 janv. 1978 et sous l’influence de celle-ci, que la responsabilité décennale était une responsabilité de plein droit.
Ce n’est qu’à la faveur de la création prétorienne des « dommages intermédiaires » – dont il sera traité ci-après pour justifier légalement une telle création – que la jurisprudence présentera l’art. 2270 comme un texte autonome sanctionnant la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage immobiliers et par « contrecoup » aura tendance à exiger, pour l’application de la garantie décennale, l’existence d’un édifice visé par le seul art. 1792.
La tendance à isoler l’art. 1792 c. civ. se manifeste également à propos de la responsabilité des locateurs d’ouvrage dans le cadre des travaux sur existants : ici, ce sera pour évincer, dans certaines hypothèses, l’application de la garantie décennale que la jurisprudence précisera que seul le droit commun de l’art. 1147 c. civ. est applicable dès lors que lesdits travaux ne sont pas constitutifs de la construction d’un édifice visé par l’art. 1792, étant précisé que, très paradoxalement ou très naturellement (puisqu’il ne s’agit pas de la construction d’un édifice), une jurisprudence très ancienne invoquait, pour appliquer la responsabilité décennale à de tels travaux, l’art. 2270 c. civ. … Ajoutons, pour être complet, que : – l’éclosion de la jurisprudence sur les dommages dits intermédiaires s’explique par la nécessité de combler le « vide juridique » né de l’évolution de la jurisprudence relative aux conditions d’application de la garantie décennale et en particulier à la condition de gravité ;
– l’éviction de la garantie décennale pour les désordres affectant des travaux neufs réalisés sur, sous ou à l’intérieur d’un bâtiment déjà existant, au prétexte qu’il ne s’agit pas de la « construction d’un édifice », a elle-même été favorisée par la publication de la loi du 4 janv. 1978 qui, en élargissant le domaine de la garantie décennale à la construction de « tout ouvrage », a redonné vigueur et importance à la notion « d’édifice »
B. – LA JUSTIFICATION DU RECOURS A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN.
S’il est admis qu’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité des locateurs d’ouvrages immobiliers ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre de la stricte application des responsabilités et garanties spécifiques instituées et organisées par les art. 1792 et 2270 c. civ., un certain nombre de dommages resteraient sans réparation.
Il en serait ainsi notamment pour :
- Les dommages résultant de l’inexécution d’obligations indépendantes de la réception ;
- Les dommages matériels à l’ouvrage dont la cause et l’origine ne résideraient pas dans un vice de construction ;
- Les dommages n’affectant pas matériellement l’ouvrage ;
- Les dommages portant sur des travaux, objet de réserves lors de la réception ;
- Les dommages qui affecteraient les gros ouvrages sans pour autant compromettre ni la solidité de l’immeuble oude l’édifice, ni sa destination.
Le recours à la responsabilité contractuelle de droit commun apparaît en conséquence comme un complément nécessaire destiné à pallier les lacunes et insuffisances des garanties légales.
Doit-on aller plus loin et estimer que la responsabilité contractuelle de droit commun doit être utilisée comme un substitut des garanties légales, notamment après l’expiration du délai d’action des garanties légales ?
Le recours à la responsabilité contractuelle de droit commun ne doit être envisagé, selon nous, que comme un complément ou un palliatif nécessaire pour combler les lacunes et insuffisances des garanties légales et en aucun cas comme le moyen de détourner les règles desdites garanties légales, notamment au regard de la prescription des actions qu’elles édictent.
L’évolution de la jurisprudence la plus récente rejoint et conforte cet avis.
En effet, sauf cas exceptionnel – celui de la faute dolosive ou extérieure au contrat, sanctionnée d’ailleurs sur le plan de la responsabilité non pas contractuelle mais délictuelle de droit commun (V. infra, III) -, la jurisprudence se refuse à faire de la responsabilité contractuelle de droit commun un outil de détournement des garanties légales.
Bien mieux, elle a tendance à considérer que les garanties légales absorbent la responsabilité contractuelle de droit commun dans certains cas et sous certaines conditions.
On distinguera les applications traditionnelles et classiques de la responsabilité contractuelle de droit commun des applications remarquées ou nouvelles de ladite responsabilité, avant de s’attacher au problème des défauts de conformité, dans le cadre desquels s’illustrent à la fois l’application et l’éviction de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il nous paraît opportun de souligner immédiatement, à ce stade de notre propos, que le fondement légal assigné à cette responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas uniforme, comme le commanderait la logique, et qu’il est fait appel à des textes aussi différents que les art. 2270, 1147 et 1648 c. civ., d’une part, et à des responsabilités aussi opposées tant en ce qui concerne les modalités de preuve (obligation de résultat, faute prouvée …) qu’en ce qui concerne leur durée, comme la durée décennale, trentenaire et, à l’occasion, le « bref délai » et singulièrement, dans ce dernier cas, en ne s’appuyant pas toujours sur l’art. 1648 c. civ. ! …, d’autre part.
- – Les applications classiques et traditionnelles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sous cette catégorie, on peut ranger l’inexécution ou la mauvaise exécution d’obligations indépendantes de la réception (a), les travaux objet de réserves lors de la réception (b).
a) L’inexécution ou la mauvaise exécution d’obligations indépendantes de la réception.
Il s’agit essentiellement : – des retards de livraison ; – des dépassements de prix, – des divers cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’obligation d’information ou de renseignement, de conseil et/ou de mise en garde.
Les retards de livraison et dépassements de prix sont considérés comme l’inexécution d’obligations de résultat sanctionnée par l’art. 1147 c. civ. et la prescription trentenaire de droit commun éventuellement ramenée à dix ans par l’effet, s’il y a lieu, de l’art. 189 bis c. com.
Les applications sont à ce point traditionnelles et classiques qu’il nous semble superflu, dans cette chronique, de les illustrer par des exemples ou des références jurisprudentielles que le lecteur trouvera dans tous les ouvrages spécialisés.
Le fondement légal de l’obligation d’information ou de renseignement, de conseil et/ou de mise en garde n’est pas toujours précisé par les juges du fond ni par la Cour suprême. En tout cas, il règne en jurisprudence une certaine confusion à cet égard, dès lors qu’elle retient, soit la responsabilité contractuelle de droit commun – par référence aux art. 1135 ou 1147 c. civ. selon les cas – soit même à l’occasion la responsabilité décennale.
Les applications jurisprudentielles sont particulièrement nombreuses et variées. Elles concernent principalement l’architecte ou le maître d’oeuvre en général, notamment quant à sa défaillance au cours des opérations de réception, la jurisprudence retenant sa responsabilité, généralement sur le fondement de l’art. 1147 c. civ. lorsqu’il ne signale pas au maître d’ouvrage les vices ou défauts de conformité apparents ou ne lui suggère pas, s’il y a lieu, de refuser la réception : dans ces hypothèses, la jurisprudence décide que la réception sans réserves du maître de l’ouvrage n’a aucun effet exonératoire à l’égard de l’architecte ou du maître d’oeuvre.
Là encore, on se reportera aux ouvrages spécialisés ainsi qu’à une étude particulièrement approfondie de M. Llorens(18).
- Les travaux objet de réserves lors de la réception.
Les garanties légales sont des garanties des vices cachés de la construction lors de la réception.
Les dommages apparents lors du prononcé de celle-ci relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’ils ont fait l’objet de réserves expresses ; à défaut, et par suite de l’effet exonératoire de la réception, de tels dommages apparents ne peuvent donner lieu à l’application des garanties légales, ni à l’application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun sauf, comme nous venons de le voir, à l’égard de l’architecte ou du maître d’oeuvre en général.
- Les dommages affectant les VRD.
Traditionnellement, sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 4 janv. 1978, on considère que certains travaux dits de génie civil, comme les voiries et réseaux divers (VRD) assurant la desserte d’un ou plusieurs bâtiments, ne relèvent pas des garanties légales, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La jurisprudence est constante sur ce point, quoique peu claire sur le régime de cette responsabilité contractuelle de droit commun qui semble ici impliquer la nécessité de prouver une faute des locateurs d’ouvrages.
- – Les applications remarquées ou nouvelles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
On peut classer dans cette catégorie : – la réparation des dommages affectant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janv. 1967, les menus ouvrages (jurisprudence Blambel) ; – la réparation des dommages n’affectant pas matériellement l’ouvrage (erreur d’implantation) ; – la réparation des dommages dits intermédiaires sur le fondement de l’art. 2270 c. civ. (jurisprudence Delcourt) ; – la réparation des dommages affectant les canalisations extérieures au bâtiment.
- a) La réparation des dommages affectant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janv. 1967, les menus ouvrages : jurisprudence Blambel.
Bien que dépassée, la question conserve un intérêt historique et surtout didactique, dès lors qu’elle constitue l’illustration par excellence de la responsabilité contractuelle de droit commun envisagée comme un palliatif ou un complément nécessaire aux garanties légales.
Le champ d’application des garanties légales étant restreint, sous le régime du code civil de 1804 et avant la loi du 3 janv. 1967, à la perte partielle ou totale de l’édifice et/ou encore aux dommages affectant les gros ouvrages, qu’ils soient ou non les gros ouvrages d’un édifice, une partie importante de la doctrine en déduisait logiquement que par suite de l’effet exonératoire de la réception, le maître de l’ouvrage ne disposait d’aucune action, même en cas de vice caché lors de la réception, dès lors que les dommages affectaient de menus ouvrages.
La Cour suprême avait confirmé cette thèse (19). Mais, le 4 janvier 1958 (arrêt Blambel), la 1re section de la Chambre civile de la Cour de cassation, puis le 19 mai 1958 (arrêt Mareuil), la 2e section de la même Chambre admettaient la recevabilité d’une action en réparation des malfaçons affectant des menus ouvrages qualifiés comme tels par les juges du fond à une époque où la Cour s’en remettait sur ce point à leur appréciation souveraine.
Il s’agissait, dans la première espèce, de travaux de ravalement (20), dans la seconde, d’une installation de chauffage (21).
Les illustres commentateurs de ces deux décisions, René Rodière pour la première et Boris Starck pour les deux, y ont vu une application du droit commun de la responsabilité.
René Rodière affirmait : « le principe du droit commun, c’est que la responsabilité de l’entrepreneur, comme celle du vendeur, du dépositaire, du commodataire, du voiturier …, peut être mise en cause malgré une réception faite sans réserves. Mais ce qu’il faut exiger, c’est que le maître agisse très vite ».
Boris Starck soulignait, de son côté, que le caractère original des art. 1792 et 2270 « a trait non à la possibilité d’agir après la réception des travaux – que le droit commun contractuel suffit à justifier – mais au délai de dix ans dont dispose le maître de l’ouvrage pour introduire son action. C’est la durée du délai, par conséquent, qui constitue ici la règle spécifique ». S’interrogeant alors sur « le délai utile » – hors les cas prévus par les art. 1792 et 2270 – pour agir en responsabilité contre l’entrepreneur, force lui était de relever que la règle énoncée par l’arrêt du 4 janv. 1958 était particulièrement « audacieuse, sa base légale n’apparaissant pas immédiatement », dès lors que « le délai de droit commun en matière de prescription est de trente ans et c’est bien ce délai que l’on applique aux actions en responsabilité lorsque nulle disposition spéciale ne vient y déroger ».
Cependant, Boris Starck approuve, en définitive, la décision de la Cour suprême, une « théorie générale du bref délai » semblant pouvoir être dégagée, dès lors que la notion de bref délai n’est pas réservée uniquement au contrat de vente. René Rodière et Boris Starck relèvent à cet égard les divers contrats où cette nécessité est également exigée, comme en matière de contrat de transport, de vente d’animaux domestiques, etc.
On relèvera au passage qu’aucun de ces auteurs ne fait la distinction entre les art. 1792 et 2270 et que la Cour de cassation, pour sa part, « invente » une responsabilité contractuelle de droit commun très particulière pour pallier les lacunes de la loi.
Dans le cadre de la création prétorienne des dommages intermédiaires, la finalité sera identique, mais pour y parvenir, c’est-à-dire pour admettre l’existence d’une responsabilité contractuelle de droit commun palliant les lacunes de la loi et/ou, comme on l’a déjà dit, comblant le « vide juridique » créé par l’interprétation jurisprudentielle de celle-ci, la Cour suprême « déconnectera » l’art. 2270 de l’art. 1792.
Il est vrai qu’à l’époque de l’arrêt Blambel et jusqu’à la loi du 3 janv. 1967, il aurait été inopérant – pour des malfaçons affectant de menus ouvrages – de détacher l’art. 2270 de l’art. 1792 dès lors qu’aucun de ces textes, et en particulier l’art. 2270, n’envisageait une responsabilité quelconque pour les vices affectant des menus ouvrages.
- Les dommages n’affectant pas matériellement l’ouvrage : les erreurs d’implantation.
La Cour de cassation (3e Ch. civ.) rappelle, dans un arrêt du 15 févr. 1978 (Bull. civ. III, n° 85), que les locateurs d’ouvrage, et notamment l’architecte, engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun d’une durée trentenaire en cas d’erreur d’implantation.
Deux arrêts antérieurs de la Cour suprême avaient déjà admis l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas d’erreur d’implantation, l’un par référence expresse à l’art. 2270 c. civ. (22), l’autre, sans référence ou visa d’un texte quelconque (23).
On observera que l’arrêt du 6 févr. 1969 invoque, pour la première fois à notre connaissance, la responsabilité contractuelle de droit commun, tandis que les deux décisions dont s’agit ne sont pas directement rattachables, comme on l’a prétendu, à la jurisprudence Delcourt sur les « dommages intermédiaires » affectant directement l’ouvrage.
- La réparation des dommages dits intermédiaires : jurisprudence Delcourt.
Le 10 juillet 1978, dans une espèce où le code civil d’origine était applicable – mais les conditions de la solution qu’elle pose ne changent pas sous l’empire de la loi du 3 janv. 1967 – la 3e Chambre civile rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Douai aux motifs suivants : « … mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que Delcourt ne pouvait donc en être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’art. 1792 c. civ., et que les époux Dumont disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute » (24).
Il nous paraît excessif d’affirmer, comme le font notamment MM. Boubli et Blanchard, que la solution de l’arrêt Delcourt n’est ni originale, ni nouvelle. Les arrêts généralement cités à l’appui de cette affirmation sont en effet soit sans rapport aucun avec les conditions d’application de la jurisprudence Delcourt, comme l’arrêt de la 1re Chambre civile du 28 mai 1962 (25), qui censurait une cour d’appel ayant écarté l’action du maître d’ouvrage pour un dommage corporel alors que l’action ne tendait pas à l’application des art. 1792 et 2270, mais découlait de « la mauvaise exécution par l’architecte de la convention passée entre les parties », soit relatifs à des erreurs d’implantation entraînant des dommages qui ne sont pas constitutifs d’atteinte matérielle aux ouvrages.
Le seul arrêt qui pourrait être directement rattaché à la jurisprudence Delcourt est un arrêt rendu par la Chambre civile, 1re section, le 9 nov. 1964 (26). Mais cette décision n’est pas véritablement topique. Même si elle retient la responsabilité de l’entrepreneur pour faute prouvée sur le fondement de l’art. 2270, elle semble vraiment incohérente. Les dommages (défaut d’étanchéité des murs et humidité consécutive de certaines parties des murs) avaient fait l’objet de réserves expresses lors de la réception dans sa phase provisoire tandis que l’entrepreneur était intégralement réglé du montant de son marché ; règlement intégral qui équivalait, aux termes du cahier des charges, à un quitus définitif donné à l’entrepreneur. Celui-ci reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui excipaient justement de ce quitus définitif, d’une part, et d’avoir fait application, dans ces conditions, de l’art. 1792 c. civ., alors qu’il ne s’agissait pas d’un marché à forfait, d’autre part.
La Cour suprême rejette les deux moyens et, s’appuyant sur certains motifs implicites de la décision attaquée, estime que « dans ces conditions » (réserves), lesdites réceptions ne pouvaient mettre fin au délai de garantie conventionnelle inséré dans le marché et que la faute étant caractérisée, c’était « à bon droit », que la décision attaquée avait retenu la responsabilité de l’entrepreneur par application de l’art. 2270 c. civ. La Cour a approuvé donc la décision attaquée par substitution de motifs, en visant l’art. 2270 c. civ. au lieu et place de l’art. 1792.
La décision n’est pas cohérente, car l’application de l’art. 2270 (comme celle de l’art. 1792) suppose que les dommages aient été cachés lors de la réception. Logiquement, la Cour de cassation aurait dû, dès lors qu’elle entendait entériner de fait la décision critiquée, l’approuver par substitution de motifs en se fondant sur l’art. 1147 c. civ., puisqu’aussi bien les réserves expresses exprimées lors de la réception faisaient obstacle tant à l’application de l’art. 1792 qu’à l’application de l’art. 2270.
On comprend ainsi que l’arrêt Delcourt ait provoqué émotion et inquiétude dans les milieux professionnels : il leur apparut en effet immédiatement que si cette jurisprudence devait se maintenir, leur responsabilité pourrait être engagée pendant trente ans à compter d’une date indéterminée (réception ou révélation des dommages) pour des dommages par hypothèse mineurs, en tout cas moins graves que ceux dont l’action en réparation était enfermée dans un délai préfix de dix ans à compter de la réception.
Certes, la « responsabilité contractuelle » retenue par la Cour suprême le 10 juill. 1978 n’était pas précédée du visa ou d’une référence à l’art. 1147 c. civ., ni d’ailleurs du visa ou de la référence à l’art. 2270 du même code, alors que la cour de Douai avait, elle, souligné que l’action avait été engagée dans le délai de dix ans de cet article.
Mais, en fait, nous savons, par l’un des auteurs de l’arrêt Delcourt, le président Costa (27), que la Cour suprême a statué en considération de l’art. 2270 c. civ., qu’elle n’a cependant pas, mais à dessein, visé pour ne pas se lier sur la portée de ce texte et ne pas compromettre les chances de voir se poursuivre, dans le cadre de la loi du 4 janv. 1978, la jurisprudence alors instaurée sous les régimes antérieurs à cette loi ; chances indemnes, selon le président Costa, car le nouvel art. 2270 se borne à renvoyer aux seules responsabilités ou garanties spécifiques des art. 1792, 1792-2 et 1792-3 c. civ. sans pour autant « abolir la responsabilité pour faute » qui n’est donc plus gouvernée par le nouvel art. 2270, ce qui implique que, sous l’empire de la loi du 4 janv. 1978, la responsabilité contractuelle de droit commun aurait une durée trentenaire.
Ainsi, si l’arrêt Delcourt définit le régime de cette responsabilité contractuelle de droit commun (responsabilité pour faute prouvée et son domaine : les dommages « intermédiaires », c’est-à-dire les dommages ayant leur siège dans des gros ouvrages sans pour autant compromettre la solidité de l’immeuble, ni le rendre impropre à sa destination), il est – pour les raisons ci-dessus évoquées – volontairement muet sur sa durée, son point de départ et son terme.
Moins d’un an plus tard, le 29 mai 1979, la 3e Chambre civile (28), présidée par un autre magistrat, mais sur le rapport du même rapporteur que celui de l’arrêt Delcourt, énonçait la même solution, sauf que n’était plus invoquée la « responsabilité contractuelle », mais la notion de faute prouvée, sans que la durée, le point de départ et le terme de cette responsabilité pour faute prouvée fussent pour autant précisés. Si bien que, pour reprendre l’heureuse formule de M. Liet-Veaux, « tous les désespoirs étaient permis » pour les professionnels bien évidemment, tandis que tout maître d’ouvrage pouvait légitimement espérer triompher dans une action engagée postérieurement à l’expiration du délai d’action en garantie décennale, dès lors qu’elle tendrait à la réparation ou à l’indemnisation de dommages dits « intermédiaires ». On comprend, dans ces conditions, qu’un maître d’ouvrage, dont l’action avait été rejetée par suite de l’expiration du délai de la garantie décennale, ait formé un pourvoi contre une décision d’une cour d’appel à laquelle il reprochait d’avoir refusé d’appliquer l’art. 1147 c. civ. et d’avoir méconnu que « les constructeurs demeurent responsables jusqu’à l’expiration du délai de droit commun … ».
La Cour suprême se devait donc de prendre parti ; elle l’a fait, en des termes non équivoques, dans un arrêt du 11 juin 1981 (29), et qui font de l’art. 2270 c. civ. un texte commun de prescription de la garantie décennale et de la garantie contractuelle de droit commun, le point de départ étant fixé de façon univoque pour cette garantie spécifique et cette responsabilité de droit commun à la réception des travaux : « Mais attendu qu’il résulte de l’art. 2270 c. civ. qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, les architectes et entrepreneurs, sauf dol ou faute extérieure au contrat, sont déchargés de la garantie édictée par l’art. 1792 et de la responsabilité contractuelle de droit commun qui leur incombe en raison des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages de l’édifice ». On remarquera que cet arrêt est muet sur le régime de cette « responsabilité contractuelle de droit commun ».
Si chacun des arrêts qui vont suivre (30) contient un élément d’imprécision, on considère cependant que toutes ces décisions se fondent soit implicitement, soit, pour certaines d’entre elles, expressément, sur l’art. 2270 c. civ. On signalera seulement un arrêt, qui apparaît isolé, rendu le 18 oct. 1983 par la 3e Chambre civile (31) : il vise expressément l’art. 1147 c. civ. et assigne à cette responsabilité contractuelle de droit commun une durée décennale ! … dont le départ est fixé, en outre, à la réception des travaux. L’arrêt n’est pas allé jusqu’à dire que cette responsabilité était une responsabilité pour « faute prouvée », ni d’ailleurs que l’entrepreneur était tenu à l’obligation de résultat de l’art. 1147.
- d) Application de la responsabilité contractuelle de droit commun en matière de dommages affectant des canalisations extérieures à l’immeuble.
C’est par un arrêt du 26 janv. 1983 que la 3e Chambre de la Cour de cassation (32) a initié sur ce point la jurisprudence en cassant et annulant un arrêt rendu le 1er juill. 1981 par la cour d’appel de Versailles qui avait déclaré irrecevable, en raison de l’expiration du délai de garantie biennale, l’action du maître d’ouvrage contre un architecte et une entreprise au motif qu’il s’agissait, en la circonstance, d’un menu ouvrage : « … qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la canalisation rompue était située à l’extérieur du bâtiment et alors que la responsabilité contractuelle de droit commun était dès lors applicable, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient ». L’arrêt visait expressément l’art. 1147 c. civ.
Depuis, cette jurisprudence a été suivie par les juges du fond et confirmée par la Cour de cassation (33).
- – L’application et l’éviction de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre des défauts de conformité.
Le contrat d’entreprise comporte, comme le contrat de vente, deux obligations : – l’obligation de délivrance : livrer la chose construite conformément aux stipulations contractuelles ; – l’obligation de garantie : garantir la chose construite et livrée des vices cachés lors de la réception (laquelle est une obligation pour le maître de l’ouvrage), c’est-à-dire lors de son acceptation.
Les garanties légales, tant sous le régime du code civil de 1804 que sous l’empire de la loi du 3 janv. 1967, portent exclusivement sur les vices de la chose construite.
Le texte même des art. 1792 et 2270 c. civ. est sans équivoque possible à cet égard. L’art. 1792 vise expressément le « vice de construction », tandis que si l’art. 2270 ne rappelle pas expressément cette notion, il est clair qu’il ne s’applique qu’au cas où il y a « vice de construction » dès lors qu’il décharge les locateurs d’ouvrage après dix ans « de la garantie … », or il n’y a pas d’autre « garantie » que celle visée à l’art. 1792 par le biais de la « responsabilité » mise à la charge desdits locateurs d’ouvrage en cas de perte partielle ou totale de l’édifice par le « vice de construction ».
Si la « responsabilité » ou la « garantie » des art. 1792 et 2270 c. civ. ne peuvent être mise en oeuvre qu’au cas où les dommages procéderaient d’un vice de construction, cela implique inéluctablement que :
- les défauts de conformité qui ne provoquent aucun dommage à la construction ne peuvent donner lieu à la miseen oeuvre des garanties légales ;
- les dommages à la construction qui procéderaient exclusivement de défauts de conformité ne peuvent égalementdonner lieu à la mise en oeuvre des garanties légales.
Dans ces deux hypothèses, le recours à la responsabilité contractuelle de droit commun est en conséquence totalement justifié, celle-ci apparaissant comme un complément nécessaire pour pallier les insuffisances et lacunes des garanties légales. D’où l’impérieuse nécessité d’opérer la distinction entre défauts de conformité et vices de construction.
Or, cette distinction n’est pas toujours aisée à faire et ce, d’autant plus que la notion de « non-conformité contractuelle » peut être confondue ou être recoupée avec celle de « non-conformité aux règles de l’art », laquelle renvoie naturellement à l’idée de « vice de construction », d’une part, tandis que l’obligation de délivrance, qui est celle de livrer un « ouvrage conforme », peut être entendue de façon extensive comme celle de livrer un « ouvrage exempt de vices », d’autre part.
Cela explique sans doute – mais ne le justifie pas, à notre avis – que l’existence même de la distinction, comme sa justification, aient été contestées par une partie de la doctrine moderne, il est vrai surtout dans le domaine de la vente et non pas dans celui du contrat de louage d’ouvrage.
A la théorie classique et conceptualiste de la distinction posant la règle selon laquelle le défaut de conformité est constitué par la différence entre la chose promise dans le contrat et celle qui est délivrée, tandis que le vice est constitué par une altération de la chose qui « la rend impropre à l’usage auquel on la destine », selon la formulation de l’art. 1641 c. civ., se sont opposées un certain nombre de théories dites modernes : notamment la théorie fonctionnaliste qui met l’accent sur l’aspect « fonctionnel » tant du vice que du défaut de conformité et aboutit, en conséquence, à une conception moniste des obligations du vendeur, du moins en matière mobilière, conception moniste qui réalise de fait une véritable fusion des notions de vices et de défauts de conformité (34).
L’illustration la plus remarquable de cette démarche – qui nous paraît condamnable – a été réalisée par les arrêts de l’Assemblée plénière du 7 févr. 1986, dont les solutions – si l’on n’y prend garde – peuvent être parfaitement transposées dans le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage.
Fort heureusement, la doctrine spécialisée et particulièrement autorisée en la matière s’en tient, dans notre domaine, à la conception classique et conceptualiste de la distinction vices/défauts de conformité.
La jurisprudence est également dans ce sens – à l’exception toutefois d’un arrêt malheureux ou rendu par « inadvertance », selon l’expression de M. Ph. Malinvaud, dans des conditions très complexes (35) – et l’on verra que lorsque les dommages sont dus à la fois à des vices de construction et à des défauts de conformité, elle décide que la garantie légale absorbe alors la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il faut en effet distinguer plusieurs hypothèses.
Première hypothèse : le défaut de conformité n’entraîne aucun dommage à l’ouvrage.
La responsabilité contractuelle de droit commun peut légitimement être mise en oeuvre. Sa durée est trentenaire ou, si le constructeur est commerçant, décennale par application de l’art. 189 bis c. com. La durée et le délai d’action semblent devoir se confondre.
C’est à partir de la réception de l’ouvrage que devrait être computé le délai d’action trentenaire.
Une telle durée n’est-elle pas excessive ? Ne doit-on pas revenir à l’idée selon laquelle, si la durée de la responsabilité est, certes, trentenaire ou décennale selon que le locateur d’ouvrage est ou non commerçant, l’action doit être intentée à bref délai à compter de la révélation du défaut de conformité ?
En tout cas, le fait que le défaut de conformité n’entraîne aucun dommage n’est pas de nature à priver le maître d’ouvrage de toute action : la confirmation en est donnée notamment par un arrêt de la 3e Chambre civile du 17 janv. 1984 (36) : « N’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’art. 1184 c. civ., selon lequel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque cette exécution est possible, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du maître de l’ouvrage tendant à la mise en conformité de l’escalier d’une piscine qui comprend trois marches au lieu de quatre prévues au marché, a retenu que la preuve n’était pas rapportée que cette modification soit de nature à rendre malaisé l’accès de la piscine, sans rechercher si la remise en état des lieux était impossible ».
- Philippe Jestaz souligne, dans son commentaire du sommaire de cet arrêt, que la position des juges du fond est peut-être encouragée par les dispositions de l’art. 1147, qui dispose « le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts », ce qui signifie que le créancier de l’obligation obtiendra réparation s’il démontre avoir subi un préjudice. Cet auteur soutient que c’est seulement lorsque la réparation en nature s’avère impossible que le maître de l’ouvrage devrait, théoriquement au moins, démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir une réparation en dommages et intérêts.
Les juges du fond procèdent à une analyse identique, dès lors qu’après avoir relevé que la substitution d’un matériau à un autre sans but lucratif n’a eu aucune conséquence dommageable, ils se refusent à la réfection demandée, qui ne leur apparaît pas – dans ces conditions – nécessaire (37).
Deuxième hypothèse : le défaut de conformité entraîne un dommage ne relevant pas des garanties légales.
Ici aussi, en cas de dommages ne relevant pas des garanties légales et dont la cause exclusive est un défaut de conformité, on doit admettre que la réparation de tels dommages, comme la remise en état conforme à la promesse, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. On soulignera que cette hypothèse ne recoupe pas celle des dommages intermédiaires qui concerne des dommages ne relevant pas des garanties légales mais procédant, non d’un défaut de conformité, mais d’un vice de construction.
Le défaut de conformité entraînant des dommages ne relevant pas des garanties légales, relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun : mais quelle responsabilité contractuelle de droit commun ?
En principe, il s’agit de celle de l’art. 1147 c. civ., encore que la portée générale de certains arrêts de la Cour suprême, dans le cadre de la jurisprudence Delcourt et/ou dans le cadre de l’application de l’art. 2270, n’exclut pas que l’on puisse considérer que les défauts de conformité entraînant des dommages ne relevant pas des garanties légales doivent être traités, tant du point de vue de leur régime (faute prouvée et non obligation de résultat) que du point de vue de leur prescription (décennale à compter de la réception), comme des dommages intermédiaires.
Troisième hypothèse : le défaut de conformité entraîne des dommages dont les caractéristiques techniques sont celles des dommages relevant normalement des garanties légales.
On doit distinguer selon que le défaut de conformité est une des causes ou la cause unique des dommages relevant des garanties légales.
De fait, cette distinction ne sera faite que par souci de précision car, comme nous allons le voir, la solution est identique dans les deux cas de figure.
- Le défaut de conformité n’est que l’une des causes des dommages. Dans cette hypothèse, il est depuis longtemps jugé que les garanties légales absorbent la responsabilité contractuelle de droit commun et que seront applicables, selon le siège du dommage et la nature de l’ouvrage considéré, la garantie biennale et/ou la garantie décennale et/ou encore dans certains cas – abstraction faite même de la nature de l’ouvrage – la responsabilité décennale.
- Le défaut de conformité est la cause exclusive des dommages. En stricte logique, si le défaut de conformité est lacause exclusive des dommages, on devrait admettre l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun même si lesdits dommages présentent les caractéristiques techniques de ceux relevant des garanties légales. La cour de Paris l’a admis : statuant après un arrêt du 22 mai 1987 (38), où elle avait relevé d’office le moyen et invité les parties à conclure sur ce point, elle a rendu, le 21 janv. 1988 (39), un arrêt retenant la responsabilité contractuelle de droit commun en présence de dommages qui résultaient exclusivement de non conformités contractuelles (défaut de ferraillage du béton contrairement au document contractuel) et ce, d’autant plus que le délai d’action en garantie décennale était expiré …
- Malinvaud et Boubli, dans leur commentaire de cette décision, l’approuvent, « à une réserve près toutefois : l’absence de ferraillage n’était-elle pas également une contravention aux règles de l’art ? Si tel était le cas, il y aurait là double qualification, ce qui devrait entraîner l’application des art. 1792 et 2270 et non de l’art. 1147 ».
On retrouve les difficultés ci-dessus signalées. Le défaut de conformité est souvent une non-conformité aux règles de l’art. Il est clair que, dans la plupart des cas, le devis descriptif établi par l’architecte ne fait que reprendre et expliciter, au cas d’espèce considéré, les règles de l’art. Ajoutons que les devis descriptifs, comme les marchés, prescrivent toujours que l’entrepreneur devra exécuter ses travaux « conformément aux règles de l’art », normes, DTU, etc.
Ainsi, la non-conformité aux règles de l’art est à la fois un vice de construction, puisque les « règles de l’art » sont les règles de l’art de construire, et une non-conformité contractuelle, puisque le contrat stipule leur respect … La question est, on le voit, extrêmement complexe car, en définitive, le défaut de conformité « pur et dur » n’existe pas en pratique et/ou encore plus précisément, ne peut être réduit à l’une de ces faces. Tel Janus, il présente deux visages …
Aussi, nous ne pouvons qu’approuver la position clairement exprimée à trois reprises par la Cour suprême dans des arrêts des 13 avr. 1988 (40), 25 janv. 1989 (41) et 4 oct. 1989 (42) qui, à l’inverse de ce qu’a jugé la cour de Paris, pose la règle suivante : « même s’ils ont comme origine des non-conformités aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (43).
On observera que la Cour de cassation envisage l’hypothèse d’une non conformité qui aurait été la cause exclusive des dommages. Elle décide ainsi nécessairement que la garantie décennale absorbe la responsabilité contractuelle de droit commun dans tous les cas et, notamment, dans le cas où les dommages ne résulteraient pas exclusivement d’un défaut de conformité dès lors que les dommages dont s’agit sont techniquement de la nature de ceux relevant d’une garantie légale comme la garantie décennale.
Cette jurisprudence a donc pour conséquence d’anéantir le délai de prescription de droit commun.
En absorbant la responsabilité contractuelle de droit commun, les garanties légales absorbent toutes les règles de celle-ci, tant au regard du régime de responsabilité que du délai d’action.
- – Garanties légales sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978 et responsabilité contractuelle de droit commun en marge du domaine d’application de cette loi. A. – GARANTIES LEGALES.
On sait que la loi du 4 janvier 1978 :
- a édicté la responsabilité de plein droit d’une durée de dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves
(combinaison des art. 1792 et 2270 c. civ.), pesant sur tout constructeur (qu’elle définit à l’art. 1792-1) d’un ouvrage (notion qu’elle ne définit pas) et ce : – pour les dommages qui compromettent la solidité des éléments constitutifs de l’ouvrage (art. 1792) ; – pour les dommages qui affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination (art. 1792) ; – pour les dommages qui affectent la solidité d’un élément d’équipement d’un bâtiment si ledit élément d’équipement est indissociable, au sens de la loi, des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert dudit bâtiment (art. 1792-2).
- a institué une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception avecou sans réserves pour les dommages compromettant le bon fonctionnement des éléments d’équipement d’un bâtiment dissociables (par opposition à l’élément d’équipement indissociable) (art. 1792-3, art. 1792-2, art. 2270).
- a institué une garantie de parfait achèvement d’un an à compter de la réception avec ou sans réserves couvrant« tous les désordres » signalés dans les conditions prévues par la loi (au moment de la réception pour ceux apparents et pendant le délai d’un an pour ceux qui se révéleraient postérieurement à la réception) (art. 1792-6).
On sait également que la loi du 4 janv. 1978 se distingue des régimes antérieurs en ce que notamment :
– elle fait courir tous les délais des garanties et responsabilités qu’elle édicte à compter de la réception avec ou sans réserves à l’inverse de ce que la jurisprudence – dans le cadre des régimes antérieurs – puis le décret du 22 déc.
1967 pour les bâtiments à usage d’habitation ou à caractéristiques similaires (art. 8 du décret) avaient décidé (délais ne commençant à courir qu’à compter de la constatation de l’apurement des réserves) ;
– elle ne vise plus la notion de vice de construction et s’attache aux caractéristiques et conséquences des dommages, abstraction faite de leurs causes et origines.
Divers problèmes tenant à la mise en oeuvre et à l’application de ces diverses garanties renvoient naturellement à l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Nous ne ferons ici que les évoquer ou reprendre certains d’entre eux de façon au moins sommaire lorsque nous nous attacherons à déterminer le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun en marge des garanties légales.
Il s’agit notamment : – du problème du droit d’option et/ou du cumul de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, problème lié à celui du régime juridique des réserves formulées lors de la réception et à la nécessité de distinguer lesdites réserves des réclamations formulées postérieurement à la réception pendant le délai de la garantie de parfait achèvement ; – du problème du délai d’action judiciaire pour sanctionner la garantie de parfait achèvement ; – du problème du sort des dommages affectant la solidité ou le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement lorsque l’ouvrage considéré n’est pas un bâtiment.
- – LES APPLICATIONS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN EN MARGE DES GARANTIES LEGALES.
Le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun en marge des garanties de la loi du 4 janv. 1978 sera inéluctablement plus restreint que celui en marge des garanties des textes antérieurs, même si certaines solutions auparavant adoptées sont parfaitement transposables.
Si l’on fait abstraction – pour ne pas relancer un débat sans doute inopportun – de l’origine des garanties spécifiques, comme de l’accentuation du caractère légal desdites garanties et responsabilités instituées ou organisées par la loi du 4 janv. 1978, cinq raisons restreignent, selon nous, le domaine d’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui mérite encore plus ici l’appellation que l’on rencontre quelquefois en doctrine de « responsabilité résiduelle de droit commun », savoir :
- L’extension considérable du domaine des garanties légales et plus particulièrement du domaine de la garantiedécennale par l’effet de la loi du 4 janv. 1978 qui a vocation à s’appliquer à tous les ouvrages immobiliers qu’ils soient ou non des édifices (et de leurs sous-catégories que sont les bâtiments), les VRD, les ouvrages d’art, de génie civil et autres ouvrages qui ressortissent désormais à ladite garantie.
- L’institution de la garantie de parfait achèvement qui s’applique à tous les désordres, y compris ceux qui nerelèvent pas normalement des autres garanties légales.
- L’éventuelle absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par la garantie de parfait achèvementpour les dommages relevant de cette dernière garantie qui n’auraient pas fait l’objet, en cas d’inexécution de l’entrepreneur concerné, d’une action judiciaire pendant le délai de ladite garantie.
- L’inéluctable absorption par l’effet de la loi des défauts de conformité entraînant des dommages à l’ouvrageprésentant les caractéristiques techniques et juridiques de ceux relevant normalement des garanties légales.
- L’impossibilité, selon nous, d’un maintien de la jurisprudence sur les dommages dits intermédiaires dans les termes actuels, sauf à envisager une action à bref délai.
Nous distinguerons ici les solutions dégagées en marge des garanties légales antérieures et qui sont transposables en marge des garanties issues de la loi du 4 janvier 1978, des solutions nouvelles ou faisant difficulté.
Les solutions transposables.
Sont parfaitement transposables sans qu’il soit nécessaire d’y consacrer des développements justificatifs à l’évidence :
- Les dommages liés à l’inexécution ou à la mauvaise exécution d’obligations indépendante de la réception, commeles retards de livraison, les dépassements de prix, la mauvaise exécution ou l’inexécution de l’obligation d’information, de conseil et/ou de mise en garde, encore que, en ce qui concerne ce dernier point, on puisse se demander si un tel manquement ne doit pas, désormais, relever des garanties légales puisque celles-ci ne s’attachent plus aux causes et origines des dommages.
- Les dommages n’affectant pas matériellement l’ouvrage, comme les erreurs d’implantation, étant observé que M.F. Desportes, au terme d’un raisonnement intéressant auquel nous ne pouvons cependant souscrire, rattache la réparation de ces dommages aux garanties légales au prétexte que la réparation de tels dommages implique une atteinte matérielle à l’ouvrage dès lors qu’il faut démolir pour reconstruire (44).
- Les dommages objet de réserves à la réception. Certains avaient cru pouvoir rattacher ces derniers dommagesaux garanties légales en raison de ce que le point de départ des différentes garanties légales est fixé par la loi du 4 janv. 1978 à la réception avec ou sans réserves. C’était, à la fois : – confondre durée effective d’une responsabilité dans certains cas et computation du délai d’action de mise en oeuvre de cette responsabilité, point de départ du délai d’action et possibilité effective de mise en oeuvre de l’action dont s’agit ; – et ignorer la nature de la garantie décennale – comme celle de la garantie biennale de bon fonctionnement – qui demeure, sous l’empire de la loi du 4
janv. 1978, une garantie, sinon des vices cachés, du moins des dommages cachés lors de la réception, dont la nature et les effets étaient, par la même occasion, également ignorés.
Nous avons déjà démontré dans d’autres colonnes (45) l’inanité d’une telle position et une kyrielle d’arrêts de la Cour suprême, dont le premier remonte au 29 avr. 1987 (46), rejoint notre analyse et décide que les réparations des malfaçons, objet de réserves lors de la réception, ne ressortissent pas à la garantie décennale (47).
La réparation des dommages, objet de réserves lors de la réception, ressortit donc incontestablement toujours à la responsabilité contractuelle de droit commun concurremment avec la garantie de parfait achèvement instituée justement en vue de leur apurement, sauf à régler le problème épineux, que nous examinerons ci-après, de savoir si ladite responsabilité contractuelle de droit commun survit ou non à l’expiration de la garantie de parfait achèvement au cas où elle n’aurait pas fait l’objet d’une action judiciaire dans le délai d’un an, c’est-à-dire si dans cette hypothèse la garantie de parfait achèvement absorbe ou non la responsabilité contractuelle de droit commun, restreignant par la même occasion considérablement sa durée et son domaine d’action.
- Les défauts de conformité n’entraînant aucun dommage matériel à l’ouvrage. Sauf à envisager, pour cette catégorie de préjudice, la nécessité d’agir à bref délai pour les raisons ci-dessus exposées, il est clair que la réparation d’un tel défaut de conformité ressortit à la responsabilité contractuelle de droit commun d’une durée trentenaire à compter de la réception.
- Les défauts de conformité entraînant des dommages ne relevant pas des garanties légales. Sauf à envisager,pour cette catégorie de dommage, la nécessité d’agir à bref délai, il est clair que la réparation de ces dommages ressortit à la responsabilité contractuelle de droit commun d’une durée trentenaire à compter de la réception.
- L’éviction de la responsabilité contractuelle de droit commun quand les dommages présentent les caractéristiquestechniques de ceux réparables au titre des garanties légales et ce, qu’ils soient dus à la fois à des vices de construction et à des défauts de conformité ou qu’ils soient seulement et exclusivement dus à des défauts de conformité. Sur ce dernier point, la solution dégagée par les arrêts des 13 avr. 1988, 25 janv. et 4 oct. 1989 est d’autant plus transposable que, comme le souligne le Rapport de la Cour de cassation pour l’année 1988, la généralité des termes utilisés vise à la fois les situations antérieures et postérieures à la loi du 4 janv. 1978, l’arrêt du 13 avr. 1988 faisant « figure d’arrêt de principe » (rapport préc., p. 224) d’une part, et que la loi fait abstraction des origines et causes des dommages, d’autre part. Les solutions nouvelles ou faisant difficulté.
On examinera essentiellement : – la question de savoir si la garantie de parfait achèvement n’absorbe pas, dans certaines conditions qui seront précisées ci-après, la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise en oeuvre judiciaire de ladite garantie et pendant le délai d’action de celle-ci ; – la question de l’éventuelle poursuite de la jurisprudence sur les dommages dits intermédiaires en marge des garanties de la loi du 4 janv. 1978 après l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
1) La garantie de parfait achèvement se cumule-t-elle ou absorbe-t elle la responsabilité contractuelle de droit commun ?
La garantie de parfait achèvement s’applique à tous les désordres et ce, quelles qu’en soient les causes et origines et les caractéristiques techniques dès lors qu’ils ont été signalés dans les conditions prévues par la loi, c’est-à-dire soit au moyen de réserves expresses portées sur le procès-verbal lors du prononcé de la réception, soit, pour ceux survenus postérieurement, au moyen de réclamations écrites notifiées pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.
La question de l’absorption ou du cumul de la garantie de parfait achèvement avec la responsabilité contractuelle de droit commun se pose dans le cas où la garantie de parfait achèvement ne pourrait plus être judiciairement mise en oeuvre en raison de l’expiration du délai d’exercice d’un an de ladite garantie.
Pour bien cerner la question ici envisagée, il convient de rappeler :
- qu’aux termes de l’art. 2270 nouveau c. civ., le point de départ des garanties et responsabilités légales se situetoujours à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves ;
- que l’existence de réserves à la réception de l’ouvrage fait cependant obstacle à la mise en oeuvre desditesgaranties pour les travaux objet de ces réserves tant que celles-ci n’ont pas été apurées ;
- qu’il existe au profit du maître d’ouvrage un droit d’option entre la garantie de parfait achèvement et la garantiedécennale, comme l’a clairement tranché la Cour suprême le 4 févr. 1987 (48), solution parfaitement transposable à la garantie biennale de bon fonctionnement, étant rappelé que ce droit d’option n’existe que pour les dommages clandestins à la réception et se révélant postérieurement à celle-ci.
Cette question ne se pose donc pas pour les dommages, quelle qu’en soit leur cause (défaut de conformité ou vice de construction), se révélant postérieurement à la réception, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, qui n’ont pas pour autant fait l’objet d’une action judiciaire au titre de ladite garantie, alors que par ailleurs lesdits dommages présentent les caractéristiques techniques de ceux relevant normalement, soit de la garantie décennale, soit de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Pour ces dommages, le maître d’ouvrage pourra, postérieurement à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, agir au titre de l’une ou l’autre des garanties décennale ou biennale de bon fonctionnement, selon le cas d’espèce, dans le délai de dix ans ou de deux ans à compter de la réception (art. 2270 nouveau c. civ.).
Le problème ne peut donc se poser que relativement :
- aux dommages apparents à la réception et objet de réserves expresses lors du prononcé de celle-ci et ce, qu’ellesque soient les origines, causes et conséquences desdits dommages qui n’auraient pas fait l’objet d’une action judiciaire pendant le délai de ladite garantie ;
- aux dommages cachés lors de la réception se révélant postérieurement à celle-ci et ne présentant pas les caractéristiques techniques de ceux pouvant relever, soit de la garantie décennale, soit de la garantie biennale de bon fonctionnement et qui, pour autant, n’auraient pas fait l’objet d’une action judiciaire pendant le délai de la garantie de parfait achèvement alors qu’ils seraient apparus à l’intérieur dudit délai.
Aucune distinction ne semble devoir être opérée entre ces deux cas de figure : le problème se pose dans les mêmes termes.
Si le maître d’ouvrage n’obtient pas la réparation ou l’indemnisation des deux catégories de dommages ci-dessus envisagées et s’abstient de toute initiative judiciaire aux fins d’exécution forcée ou d’une indemnisation, peut-il néanmoins, malgré son inertie, engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur concerné et des autres locateurs d’ouvrage qui pourraient être également concernés par lesdits dommages sur le fondement de l’art. 1147 c. civ. ?
Dans deux arrêts des 19 avr. 1989 (49) et 3 mai 1989 (50) la Cour suprême a nettement déclaré, à propos des dommages objet de réserves à la réception – mais la généralité des termes employés implique que la solution est transposable aux désordres notifiés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement – que la garantie de parfait achèvement doit judiciairement être mise en oeuvre dans le délai de ladite garantie.
Certes, la Cour de cassation n’a rien dit de plus, mais il semble exclu que les auteurs de ces arrêts ne se soient pas posé la question que nous posons ici ; statuant, il est vrai, dans les limites des moyens qui lui sont soumis, et s’agissant d’arrêts de rejet et non de cassation, il lui était sans doute plus difficile d’ajouter au visa de l’art. 1792-6 la référence à l’art. 1147 c. civ.
Aussi, pensons-nous, bien que les arrêts des 19 avril et 3 mai 1989 ne soient pas significatifs au regard de la question ici posée, que sur ce point la Cour suprême tendrait à admettre l’absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par la garantie de parfait achèvement dans les cas envisagés ci-dessus.
De fait, la question est extrêmement complexe tant en droit qu’en équité.
Si on opte pour la non-absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les conditions ci-dessus rappelées par la garantie de parfait achèvement, il est clair que l’on permet au maître d’ouvrage, coupable d’inertie, d’agir pendant trente ans à compter de la réception.
Si l’on décide, en revanche, qu’il y a bien absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par la garantie de parfait achèvement, il est clair que l’on introduit une inégalité entre les locateurs d’ouvrage dès lors que la garantie de parfait achèvement de « l’entrepreneur concerné » n’est évidemment pas exclusive de la garantie contractuelle de droit commun des autres locateurs d’ouvrage (51), notamment de l’architecte et autres maîtres d’oeuvre, ni de celle du contrôleur technique qui resteraient tenus de leur responsabilité contractuelle de droit commun pendant une durée de trente ans à compter de la réception des travaux, durée éventuellement réduite, par application de l’art. 189 bis c. com., à dix ans.
Ainsi, l’expiration de la garantie de parfait achèvement aurait un effet extinctif pour « l’entrepreneur concerné » au titre des défauts de conformité et désordres de natures diverses dont certains peuvent être graves – comme ceux objet de réserves lors de la réception, au nombre desquels pourraient se trouver des désordres dont les caractéristiques techniques ressortiraient à la garantie décennale -, tandis que les autres locateurs d’ouvrage resteraient tenus sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun à la réparation de ces désordres.
L’hésitation est donc légitime. Deux éléments nous incitent cependant à opter pour une réponse affirmative.
Le premier réside dans le fait qu’en matière de vente d’immeubles à construire, la loi institue au profit de l’acquéreur un régime particulier pour les vices de construction apparents lors de la prise de possession. Aux termes de l’art. 1642-1 c. civ., le vendeur ne peut être déchargé, notamment avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession, desdits vices de construction alors apparents. L’art. 1648, al. 2, du même code oblige l’acquéreur à agir, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
L’acquéreur ne dispose donc, pour les vices apparents, que d’un délai maximum de treize mois à compter de la prise de possession pour agir.
On voit mal les raisons qui conduiraient à accepter dans ces conditions qu’un maître d’ouvrage, souvent professionnel – c’est le cas en tout cas dans le cadre des ventes d’immeubles à construire -, puisse recourir à l’encontre de l’entrepreneur concerné postérieurement à l’expiration de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun d’autant plus que, par ailleurs, l’acquéreur lui-même ne peut, en l’état de la jurisprudence, agir sur ce fondement contre les autres locateurs d’ouvrage (V. ci-après, IV).
Le second élément réside dans le fait qu’en ce qui concerne les défauts de conformité cachés à la réception et ressortissant, en raison de leurs caractéristiques techniques, à la garantie décennale, la Cour suprême, dans l’arrêt de principe précité du 13 avr. 1988, a proposé la règle selon laquelle, « même s’ils ont comme origine une nonconformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Cette règle a été posée dans un cas d’espèce où le délai d’action de cette garantie légale, qui était en la circonstance la garantie décennale, était expiré, tandis que celui de l’art. 1147 c. civ., d’une durée trentenaire, ne l’était pas.
Ne peut-on pas transposer ici cette règle, qui a été confirmée comme on l’a vu par deux autres arrêts des 25 janv. et 4 oct. 1989 (V. notes 40, 41 et 42), et estimer que tous les défauts de conformité et désordres qui relèvent de la garantie de parfait achèvement – qui est une garantie légale même si elle n’est pas d’ordre public – ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsque le délai d’action de cette « garantie légale » est expiré ?
Une telle solution :
- priverait le maître de l’ouvrage de la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droitcommun pour les défauts de conformité et désordres objet de réserves lors de la réception – quelles que soient les caractéristiques et conséquences desdits défauts de conformité et désordres -, mais qui n’auraient pas fait l’objet d’une action judiciaire au titre de la garantie de parfait achèvement pendant le délai de cette garantie.
- priverait le maître de l’ouvrage de la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droitcommun pour les défauts de conformité et désordres mineurs survenus postérieurement à la réception pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et objet de réclamations pendant ledit délai et qui n’auraient pas fait l’objet d’une action judiciaire pendant le délai de ladite garantie.
- mais ne priverait pas le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de la possibilité d’agir sur le fondement de la garantiedécennale, dès lors qu’il s’agirait de défauts de conformité ou de désordres graves, clandestins à la réception et qui se seraient révélés postérieurement à son prononcé pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.
Elle implique cependant que l’on décide que l’expiration de la garantie de parfait achèvement ait également un effet extinctif à l’égard des autres locateurs d’ouvrage que « l’entrepreneur concerné ».
Telle qu’envisagée, cette solution sanctionnerait ainsi l’inertie du maître de l’ouvrage qui n’aurait pas agi dans le délai d’un an pour certains dommages graves, objet de réserves à la réception, ou mineurs, objet de réserves à la réception ou de réclamations pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.
2) La jurisprudence Delcourt peut-elle se poursuivre en marge des garanties légales issues de la loi du 4 janvier 1978 ?
Contrairement à l’avis général et à certaines décisions isolées, nous ne le pensons pas, car les notions de vice de construction et de gros ouvrage sont absentes de la loi du 4 janv. 1978, d’une part, et que si l’on veut, par analogie, appliquer une solution semblable aux « éléments constitutifs de l’ouvrage » du nouvel art. 1792 c. civ. et/ou encore aux éléments d’équipement de l’art. 1792-2, dont la réparation ou l’indemnisation seraient admises alors que les dommages n’affecteraient pas leur solidité, voire aux éléments d’équipement dissociables de l’art. 1792-3, alors même que les dommages n’affecteraient pas leur fonctionnement, le seul fondement légal d’une telle solution ne pourrait trouver sa source que dans l’art. 1147 c. civ., d’autre part.
Or, une telle solution serait d’autant plus inique et injustifiée qu’elle entraînerait une responsabilité objective l’obligation de résultat ne cédant que devant la preuve d’une cause étrangère – d’une durée trentenaire à compter de la réception pour des dommages par hypothèse moins graves que ceux ressortissant aux garanties légales et dont la réparation ou l’indemnisation serait assurée dans des conditions aussi sévères que les garanties légales quant à la mise en oeuvre de la responsabilité (pas d’exigence de la démonstration d’une faute) et encore plus sévères quant à la durée de cette responsabilité (trente ans au lieu de dix ans, voire au lieu de deux ans).
III. – Le problème particulier du dol ou de la faute « extérieure au contrat », responsabilité délictuelle ou contractuelle de droit commun ?
A l’exception d’un arrêt rendu le 2 juill. 1975 (52), qui ne se prononce pas sur la nature de la responsabilité engagée, et d’un arrêt remarqué du 5 janv. 1983 (53), qui se prononce en faveur de la nature contractuelle de l’action, la Cour de cassation, pour écarter les prescriptions « abrégées » de l’art. 2270 c. civ. et retenir postérieurement à l’expiration des délais qu’énonce ce texte – la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le plan quasi délictuel pendant une durée trentenaire à compter de la révélation du dommage, invoque la notion de « faute dolosive », d’une part, et celle de « faute extérieure au contrat », d’autre part, notion qu’elle ne distingue d’ailleurs toujours pas.
Le caractère artificiel, contradictoire et « vicieux » (l’expression est de Mme Joëlle Fossereau) de la notion de faute dolosive, qui est nécessairement contractuelle et qui est retenue sur le fondement quasi délictuel au mépris de la règle du non-cumul, a été dénoncé par une doctrine unanime.
« Même transmise de rapporteur à rapporteur, l’erreur, serait-elle commise par la Cour de cassation, ne devient pas vérité », écrivait Jean Mazeaud en exergue de son commentaire d’un arrêt rendu le 18 déc. 1972 par la 3e Chambre civile (54).
La « délictualisation » de la faute dolosive est d’autant plus évidente et artificielle que la Cour suprême n’hésite pas à invoquer la notion de « faute dolosive dans l’exécution du contrat » (55) et/ou encore le fait que les locateurs d’ouvrage avaient, d’une part, « délibérément failli à leurs obligations contractuelles … » (56), et affirme encore que « si lourdes que soient les fautes reprochées par le maître de l’ouvrage à l’architecte ou aux entrepreneurs relatives à des manquements à leurs obligations contractuelles, l’action en garantie est éteinte après l’expiration du délai de dix ans » (57), d’autre part.
Quant à la « faute extérieure » au contrat, que la Cour de cassation oppose à la « faute dolosive dans l’exécution du contrat » pour lui appliquer les mêmes règles de la responsabilité quasi délictuelle au mépris encore de la règle du non-cumul, on la chercherait en vain dans les espèces soumises à la censure de la Cour.
Dans le dernier état de la jurisprudence, la faute dolosive suppose non seulement la conscience de la faute, mais encore la volonté de réaliser le dommage (58), alors que, jusqu’ici, semble-t-il, la Cour suprême se contentait de la conscience du caractère inéluctable de la survenance du dommage.
Il est clair, en tout cas, que la « passivité » du locateur d’ouvrage n’est pas suffisante pour engager la responsabilité délictuelle, même si cette passivité est assimilée à une faute lourde (59).
Ce qui domine, c’est l’idée de fraude, de dissimulation frauduleuse du vice (60), de manoeuvre (61) ; mais la fraude est-elle pour autant détachable de l’exécution du contrat ?
Le débat a été jusqu’ici purement théorique et sans incidence pratique dès lors que dans les deux cas, responsabilité délictuelle ou responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité était toujours d’une durée trentenaire, sauf l’hésitation en ce qui concerne le point de départ de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est, selon les auteurs, situé à la réception des travaux ou encore à la révélation du dommage, tandis que le point de départ de la responsabilité délictuelle est situé, bien évidemment, à la révélation du dommage.
Le débat a aujourd’hui, par l’effet de la loi Badinter du 5 juill. 1985, des conséquences pratiques certaines dès lors que la responsabilité extra contractuelle a désormais une durée de dix ans à compter de la révélation du dommage ou de son aggravation.
Si, à l’évidence, – sauf bien évidemment la démonstration d’une faute « véritablement » extérieure au contrat – la responsabilité engagée est nécessairement contractuelle, on doit admettre que le point de départ de cette responsabilité est forcément la date de la réception, laquelle constate la complète exécution des obligations contractuelles.
On doit conserver l’idée que la faute lourde ne doit pas être assimilée au dol ; à défaut, ce serait permettre trop aisément l’éviction du délai de dix ans et/ou de deux ans des garanties légales.
En d’autres termes, le recours à la notion de dol ne doit pas permettre de « frauder » la loi. La notion de dol doit être cantonnée au domaine de la fraude, de la tromperie, des manoeuvres en vue de dissimuler des malfaçons, et à celui des malfaçons réalisées volontairement avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences et, éventuellement, l’intention de nuire, eu égard au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation.
- – Le problème irritant de la transmissibilité de l’action contractuelle de droit commun.
On sait que, bien avant la loi du 4 janv. 1978, et encore plus précisément depuis 1953 en droit public, depuis 1967 en droit privé, la jurisprudence admet la transmission des garanties légales à l’acquéreur de l’ouvrage.
On sait que, parallèlement, et pour le moins de façon claire depuis 1979, la jurisprudence admet, en matière de vente de chose mobilière, la transmission de l’action contractuelle de droit commun au profit des acquéreurs successifs, action cantonnée, dans un premier temps, à la possibilité de demander des dommages et intérêts, puis étendue à la possibilité d’exercer l’action rédhibitoire pour vice caché de l’art. 1648 c. civ.
On sait enfin que par arrêts de l’Assemblée plénière du 7 févr. 1986 (62), la Cour suprême a étendu la transmission de l’action contractuelle de droit commun au défaut de conformité dans des conditions contestables, et pour contourner l’obstacle de l’expiration du bref délai d’action de l’art. 1648 c. civ.
Les arrêts d’Assemblée du 7 févr. 1986 sont le germe qui permettra la floraison et la consécration jurisprudentielle de ce qu’il est convenu d’appeler un « puissant courant doctrinal » prônant la transmission de l’action contractuelle de droit commun en toute matière et quasiment dans tous les cas, dès lors que la victime n’aura souffert du dommage que parce qu’il avait un lien avec le contrat initial (63) et qu’elle agit dans la double limite de ses droits à l’égard du débiteur principal et de l’engagement du débiteur substitué (64).
On sait également qu’il n’y a pas unité de jurisprudence : la 3e Chambre civile refuse d’admettre, pour des motifs de pur droit difficilement contestables, la transmission de l’action contractuelle de droit commun tant au profit du maître de l’ouvrage en cas d’action à l’encontre d’un sous traitant (dont elle ne conçoit la possibilité que sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle de droit commun (65)), qu’au profit de l’acquéreur de l’ouvrage en cas d’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage (66), et qu’au profit des locataires (67) et autres titulaires d’un simple droit de jouissance comme les locataires-attributaires (68).
La question est donc très vaste et particulièrement irritante dans la mesure où s’opposent des intérêts tout aussi légitimes et tout aussi opposés que ceux du maître de l’ouvrage et de l’acquéreur, d’une part, et ceux des locateurs d’ouvrage, d’autre part.
Le problème est d’autant plus irritant qu’il est difficile d’admettre que l’on doive « sacrifier » les intérêts des uns au détriment de ceux des autres, car il n’y a aucune raison majeure de le faire, et surtout, parce que chacune des thèses en présence induit des inconvénients non négligeables au regard des uns et des autres.
Si la transmission de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun peut apparaître dans certains cas comme une solution opportune, il reste qu’elle nous paraît, en l’état du droit positif, radicalement intransposable, notamment pour des raisons d’opportunité.
La non-transmission de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun présente cependant, de son côté, des inconvénients majeurs.
- – LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE AU MAITRE D’OUVRAGE IMMOBILIER DE L’ACTION CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN DE L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL A L’EGARD DU SOUS-TRAITANT.
La transmission de l’action contractuelle de droit commun dans le cadre d’une action du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant d’ouvrages immobiliers présente des avantages pour le sous-traitant et des inconvénients pour le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur.
Pour le sous-traitant, cette transmission présente l’incontestable avantage – s’il est commerçant ou si son cocontractant a cette qualité, ce qui est généralement le cas – de ne pas être tenu au-delà de dix ans après la livraison de l’ouvrage, objet de la sous-traitance, à l’égard de l’entrepreneur principal et/ou au-delà de dix ans à compter de la réception de l’ensemble immobilier dans lequel est intégré l’ouvrage, objet de la sous traitance, et/ou encore au-delà de la possibilité d’action du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal sur le fondement de la garantie décennale, puisque la jurisprudence admet la possibilité pour l’entrepreneur principal d’appeler en garantie son sous-traitant après l’expiration du délai de dix ans de l’art. 189 bis c. com., s’il a lui-même été attrait en justice par le maître d’ouvrage dans le délai de dix ans de l’art. 1792.
La transmission de l’action présente aussi l’indiscutable avantage de pouvoir opposer au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur les clauses limitatives de responsabilité qui peuvent être contenues dans le contrat passé avec l’entrepreneur principal.
Pour le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, les inconvénients résultent des avantages ci-dessus décrits, savoir :
- délai d’action commençant à courir non de la révélation du dommage ou de son aggravation, mais au plus tard dela réception …
- opposabilité des clauses limitatives de responsabilité d’autant plus qu’elles seraient contenues dans le cadre d’uncontrat de droit commun.
Cette présentation suppose bien évidemment, mais cela n’est pas contestable en l’état du droit positif, que le contrat de sous-traitance, qui est indubitablement un contrat d’entreprise, soit régi par les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre cocontractants – entrepreneur principal et sous-traitant – d’une part, et que le sous-traitant ne soit pas tenu à l’égard du maître de l’ouvrage des garanties légales – ce qui est aussi incontestable – d’autre part.
On perçoit alors que le « point dur » du problème réside justement dans le fait que le sous-traitant n’est pas tenu aux garanties légales tant à l’égard de l’entrepreneur principal qu’à l’égard du maître d’ouvrage.
Une heureuse et opportune réforme législative consisterait donc à soumettre le sous-traitant aux garanties légales tant à l’égard de l’entrepreneur principal qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur.
Une telle solution supprimerait les inconvénients les plus choquants en raison et en équité pour le sous-traitant comme pour le maître de l’ouvrage et permettrait, sans aucun inconvénient semble-t-il, d’adopter la solution de la 1re Chambre civile qui devrait quand même être amendée …
Si le sous-traitant était tenu aux garanties légales à l’égard de l’entrepreneur principal, le contrat de sous-traitance ne pourrait plus comporter de clauses limitatives de responsabilité – au demeurant fort rares en pratique – et si elles existaient, elles seraient réputées non écrites par application de l’art. 1792-5 c. civ.
L’inconvénient apparent qui en résulterait pour le sous-traitant – apparent, car il est tout de même tenu dans les termes du droit commun d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme à la convention et exempt de vice – serait largement compensé par le fait, très probable, que la jurisprudence admettra plus facilement le « fait fautif » ou l’immixtion de ce maître d’ouvrage particulier que serait l’entrepreneur principal présumé compétent.
Si le sous-traitant est tenu aux garanties légales à l’égard du maître de l’ouvrage, il ne pourra certes pas exciper du fait fautif ou de l’immixtion de l’entrepreneur principal ; il ne pourra pas non plus exiger du maître d’ouvrage la démonstration d’une faute qui lui soit directement imputable et l’existence d’un lien de causalité avec le dommage, mais en revanche il bénéficiera des délais de prescription abrégés par rapport à l’application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce qui est clair en tout cas, c’est qu’en l’absence de toute réforme législative, admettre la transmission de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de sous-traitance au profit du maître de l’ouvrage est non seulement contraire à la loi, c’est-à-dire à l’art. 1165 c. civ. – car, en quelque état de déclin dans lequel il se trouve, ce texte existe toujours – mais aussi radicalement impossible au regard même de la formulation des arrêts de la 1re Chambre civile de la Cour suprême des 8 mars 1988 et 21 juin 1988, sans qu’il soit besoin en outre d’invoquer la violation de la Constitution (art. 34) et de l’art. 5 c. civ. qui interdit aux juges de prononcer des arrêts de règlement.
En effet, l’expression « limite de ses droits » peut être envisagée à la fois de façon restrictive et « négative » impliquant que le maître de l’ouvrage ne puisse agir au-delà des limites desdits droits, mais également de façon « positive » impliquant que le maître de l’ouvrage puisse agir dans la « pleine mesure de ses droits ».
Or, tolérer que le maître de l’ouvrage puisse invoquer à l’égard du sous traitant la pleine mesure des droits qu’il détient à l’encontre de l’entrepreneur principal, ce serait lui permettre d’exciper à l’encontre du sous-traitant des garanties légales auxquelles est tenu l’entrepreneur principal par application des art. 1792, 1792-2 et 1792-3, voire 1792-6 et auxquelles n’est justement pas tenu le sous-traitant par application de l’art. 1792-1 c. civ., conformément aux voeux exprès du législateur.
Si l’on envisage la formule de la 1re Chambre civile du point de vue du sous-traitant, ce serait permettre à celui-ci d’invoquer à l’encontre du maître de l’ouvrage les limites des droits de celui-ci à l’encontre de l’entrepreneur principal
: ainsi, on permettrait au sous-traitant d’exciper, soit du fait que les dommages qui affectent ses ouvrages ne ressortissent pas aux garanties légales, soit du fait qu’ils ne pourraient donner lieu à aucune action par suite de l’expiration du délai d’exercice de ses garanties ! …
On serait ainsi dans la situation paradoxale suivante : le maître d’ouvrage ne pourrait pas invoquer à l’encontre du sous-traitant la pleine mesure des droits qu’il détient à l’encontre de l’entrepreneur principal, c’est-à-dire les garanties légales, tandis que le sous-traitant pourrait, s’il lui plaît, les lui opposer.
Il y aurait là une violation caractérisée de la loi.
La situation est d’autant plus inextricable que si le maître de l’ouvrage peut invoquer à l’encontre du sous-traitant « l’étendue de son engagement » à l’égard de l’entrepreneur principal, c’est-à-dire l’obligation de résultat de réaliser et de livrer une chose construite conforme à la convention et exempte de vices, il est clair que le sous-traitant peut aussi, pour les raisons sus-indiquées, opposer au maître de l’ouvrage les limites de ses droits à l’encontre de l’entrepreneur principal.
Quel contrat privilégier ?
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, tout dommage est réparable ; dans celui des garanties légales, seuls sont réparables les dommages ressortissant auxdites garanties.
En matière de responsabilité contractuelle de droit commun, les clauses limitant celle-ci, notamment quant à sa durée, sont valables ; en matière de garantie légale, cela n’est pas possible (art. 1792-5 c. civ.).
On voit que la transposition dans le domaine immobilier d’une solution qui peut se justifier pour des raisons d’opportunité et d’équité tant dans ce domaine que dans le domaine des choses mobilières est radicalement impossible, dès lors que les responsabilités engagées de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage et du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal sont, par nature, différentes et/ou du moins sont organisées et sanctionnées différemment par la loi.
Seule une réforme législative dans les conditions que nous avons envisagées ci-dessus permettrait une solution heureuse du conflit opposant la 1re Chambre civile et la 3e Chambre civile de la Cour suprême, conflit plus apparent que réel puisque la 1re Chambre civile a statué en matière mobilière, tandis que la 3e Chambre civile statue en matière immobilière, étant cependant précisé qu’une cour d’appel avait préfiguré la solution de la 1re Chambre civile en matière immobilière (69) et que, depuis, certaines cours appliquent strictement en matière immobilière la solution de la 1re Chambre civile tandis que d’autres s’y refusent (70).
- – LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE A L’ACQUEREUR DE L’ACTION CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN DU MAITRE DE L’OUVRAGE A L’EGARD DES LOCATEURS D’OUVRAGE.
Si l’acquéreur – depuis 1953 en droit public, depuis 1967 en droit privé – bénéficie des garanties légales qui lui sont transmises, comme un accessoire de la chose vendue, en revanche la jurisprudence n’a jamais admis, semble-t il, que l’action contractuelle de droit commun lui soit transmise par l’effet de la vente (71).
La 3e Chambre civile l’a récemment rappelé dans un arrêt remarqué du 7 mai 1986 (66) qui casse, après avoir visé l’art. 1165 c. civ., un arrêt de cour d’appel qui, pour condamner l’architecte à indemniser des syndicats de copropriétaires et certains copropriétaires, après avoir exclu l’application des art. 1792 et 2270 c. civ. (rédaction de 1804), avait énoncé qu’il convenait uniquement de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans rechercher l’existence d’un lien contractuel unissant l’architecte aux syndicats.
Elle l’a à nouveau rappelé le 31 mai 1989, en déclarant qu’en l’absence de lien contractuel l’unissant aux locateurs d’ouvrage, un syndicat de copropriétaires est irrecevable à leur demander l’indemnisation de malfaçons affectant l’immeuble sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (72).
Les juges du fond s’inclinent généralement et refusent toute transmissibilité de l’action contractuelle (73).
Les arrêts de l’Assemblée plénière du 7 févr. 1986 avaient admis la transmission de l’action contractuelle comme accessoire de la chose vendue dans le cas d’une vente suivie d’un contrat d’entreprise ; doit-on écarter pour autant la transmission de l’action contractuelle dans la situation inverse, c’est-à-dire d’un contrat d’entreprise suivi d’une vente ?
La doctrine ne le pense pas (74). D’autant plus que les arrêts du 7 févr. 1986 avaient justement admis la transmission de l’action contractuelle de droit commun non au regard de la garantie des vices cachés, mais au regard de l’obligation de délivrer la chose conforme à son usage.
En réalité, la solution de la 3e Chambre civile, si elle se justifie – malgré les critiques de la doctrine selon nous – pour des motifs de pur droit, est inopportune tant pour le locateur d’ouvrage qui peut être recherché sur le fondement des règles de la responsabilité quasi délictuelle, sans pouvoir opposer strictement les limites du contrat d’entreprise, que pour l’acquéreur, dont il n’est pas certain qu’il puisse prospérer dans son action dans la mesure où il doit établir la faute du sous-traitant, « envisagée en elle-même et en dehors de tout point de vue contractuel » et le lien de causalité avec le dommage allégué.
- – LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE AU LOCATAIRE DES GARANTIES LEGALES ET DE L’ACTION CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN.
La jurisprudence refuse constamment de reconnaître au locataire le bénéfice des garanties légales réservées sous tous les régimes au maître de l’ouvrage et à l’acquéreur, ainsi que le bénéfice de l’action contractuelle de droit commun par suite de l’effet relatif des contrats (art. 1165 c. civ.), comme vient de le rappeler récemment encore la Cour de cassation (67).
La non-transmission des garanties légales et l’admission, au profit des locataires, d’une responsabilité de nature quasi délictuelle présentent le double inconvénient, d’une part, de conférer à un locataire plus de droits qu’à son auteur et, d’autre part, de permettre la collusion et la fraude éventuelle du locataire et du maître de l’ouvrage, ce dernier faisant exercer par son locataire une action qui lui serait personnellement et directement refusée.
En revanche, l’intransmissibilité de l’action contractuelle de droit commun au profit du locataire ne présente pas, selon nous, d’inconvénient particulier.
Conclusion
Le débat majeur en matière de responsabilité des locateurs d’ouvrages immobiliers n’est pas tant celui de la nature et du régime des diverses responsabilités et garanties spécifiques ou de droit commun auxquelles sont tenus ces professionnels, que celui de la durée de ces responsabilités et garanties, d’une part, et de la prescription qui leur est attachée, d’autre part.
Il est à l’évidence choquant, en raison et en équité, qu’un locataire ou un tiers quelconque puisse agir à l’encontre d’un locateur d’ouvrage postérieurement à la prescription de l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de ce dernier.
Il est à l’évidence choquant, en raison et en équité, que l’acquéreur de l’ouvrage, qui ne pourrait plus agir sur le fondement des garanties légales postérieurement à la prescription de celles-ci, puisse se placer sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle et/ou encore extra contractuelle pour rechercher néanmoins la responsabilité d’un locateur d’ouvrage sans que ledit locateur d’ouvrage puisse lui opposer les éventuelles limitations de sa responsabilité de droit commun.
Il est à l’évidence choquant, en raison et en équité, qu’un sous-traitant puisse être recherché par un maître d’ouvrage ou un acquéreur alors que toute action serait prescrite à l’encontre de l’entrepreneur principal.
S’il est douteux de pouvoir envisager, en l’état de la loi et des difficultés de transposition dans notre domaine particulier, une généralisation de l’action contractuelle pour les motifs que nous avons exposés et si l’état du droit positif ne permet pas, par ailleurs, la création d’une responsabilité de même nature et de même régime – abstraction faite de la qualité de celui qui entend mettre en oeuvre la responsabilité de cette catégorie de professionnels que sont les locateurs d’ouvrage immobiliers – et si donc il ne peut être invoqué ou créé une responsabilité professionnelle de ceux-ci, erga omnes, ne peut-on pas cependant concevoir une unification des délais d’action des garanties légales et des responsabilités de droit commun ?
La jurisprudence serait/ou est source du droit positif ; elle permet en tout cas de tracer le chemin de la Loi.
On doit saluer à cet égard la récente initiative de M. Drai, Premier président de la Cour de cassation.
Nous ne pourrions que nous réjouir si les voeux exprimés ici trouvaient, de lege ferenda, quelque écho dans le cadre des réformes législatives que ne manquera pas de susciter cette heureuse initiative.
La jurisprudence Blambel préfigurait la garantie biennale.
La jurisprudence Delcourt, qui fixe sans aucun support légal sérieux une durée de dix ans à compter de la réception pour une catégorie de dommages déterminés, ne permet-elle pas de considérer que, quelle que soit la nature des dommages, toute action en responsabilité est éteinte dans les mêmes conditions que pour ceux relevant normalement des garanties légales ?
La solution est indirectement amorcée par la jurisprudence issue des arrêts des 13 avr. 1988, 25 janv. et 4 oct. 1989 (préc.) dans les rapports du maître de l’ouvrage avec les locateurs d’ouvrage ; elle ne l’est pas à l’égard de l’acquéreur, ni des tiers, que celui-ci soit « tiers dans l’ouvrage », c’est-à-dire locataire ou locataire-attributaire, ou « tiers à l’extérieur de l’ouvrage », c’est-à-dire voisin.
Bien mieux, elle semble même compromise par l’éventuelle absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par la garantie de parfait achèvement.
Mots clés :
CONTRAT D’ENTREPRISE * Responsabilité * Droit commun * Garantie légale * Ouvrage * Réception
voir les citations dans le document pdf joint