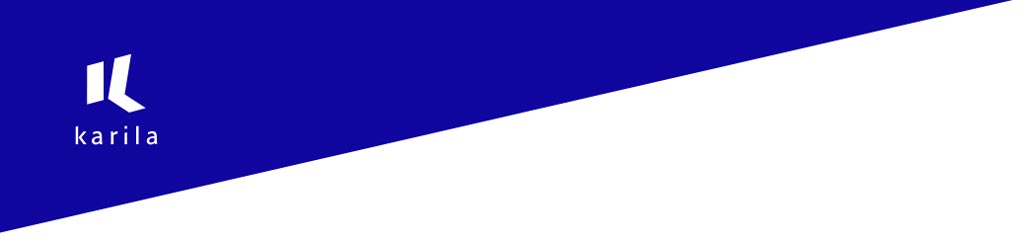Marchés privés : six mois de droit de la construction (lemoniteur.fr)
Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de Cassation au second semestre 2024.
Par Laurent Karila
Avocat associé – Karila, Société d’avocats
Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Tout membre d’un groupement momentané d’entreprises peut-il agir directement en paiement du coût des travaux réalisés ? Un maître d’ouvrage peut-il invoquer un préjudice de jouissance s’il n’a pas réalisé les travaux de réparation que l’indemnité obtenue devait financer ? Un architecte est-il responsable d’un déficit de surface du bien construit, alors qu’il n’avait reçu aucune mission complémentaire de mesurage ? La Cour de cassation a répondu à toutes ces questions, et à bien d’autres, durant le second semestre 2024.
L’ouvrage, l’élément d’équipement et la réception
Avant tout, un ouvrage ou un élément d’équipement. La troisième chambre civile de la Cour énonce que les dommages affectant des éléments d’équipement – en l’espèce, un poêle à bois -installés sur existant au terme d’un travail spécifique aux fins de raccordement, ce qui le qualifiait de contrat d’entreprise (et non de simple contrat de vente), relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et non pas de la responsabilité décennale, sauf s’ils constituent en eux-mêmes un ouvrage (Cass. 3e civ. , 5 décembre 2024, n° 23-13562). Elle vient ainsi confirmer sa jurisprudence d’il y a un an (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au Bulletin).
Réception tacite ou judiciaire. Pour emporter la réception tacite et engager la responsabilité décennale du constructeur, les juges du fond doivent caractériser la prise de possession, condition – avec le paiement d’une partie substantielle du coût des travaux – de la présomption de ladite réception tacite. Ils ne peuvent statuer par simple affirmation sans préciser les éléments dont ils déduisaient l’existence de cette prise de possession (Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-18751). La réception n’impliquant pas l’achèvement des travaux, la réception tacite de l’ouvrage peut être retenue même en cas d’abandon de chantier, dès lors que la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est caractérisée (Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 23-13283).
Lorsque les juges du fond prononcent rétroactivement la réception judiciaire d’une maison individuelle, ils doivent vérifier qu’elle était en état d’être reçue à cette date, c’est-à-dire habitable (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-24871). Lorsque l’ouvrage est un enrochement bétonné qui empiète sur un terrain situé en contrebas d’une parcelle voisine et conduit à un risque d’éboulement de la terre des voisins, à raison d’un espace demeuré vide au-dessus de l’ouvrage, la réception judiciaire peut être également prononcée, en dépit de l’erreur d’implantation, dès lors que les travaux avaient été en état d’être reçus (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-15006).
Les garanties légales
Garantie de parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement (GPA) s’étend à la réparation – outre les réserves mentionnées au procès-verbal de réception – de désordres révélés postérieurement et notifiés dans le délai d’un d’an. La Cour rappelle l’importance de ce formalisme. Ainsi, le maître d’ouvrage assigné en paiement du solde du marché de travaux ne saurait utilement, en défense, faire valoir des demandes indemnitaires fondées sur la GPA, même si le délai d’un an n’est pas expiré, dès lors qu’il n’avait pas préalablement notifié à l’entrepreneur les désordres révélés postérieurement à la réception (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12748).
Purge de garantie décennale. Dès lors que les maîtres d’ouvrage avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d’infiltration à l’origine d’inondations du sous-sol de leur propriété avant la réception des travaux et que ce désordre n’a pas été réservé, ils ne sont pas fondés à engager la garantie décennale de l’entreprise, les conditions de mise en œuvre de cette garantie n’étant pas réunies (Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-11077).
Forclusion décennale. En application de l’article 2241 du Code civil, pour interrompre le délai de forclusion des actions du maître d’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription, et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription. Ainsi, le maître d’ouvrage qui n’a pas interrompu ledit délai dans ces conditions ne peut tirer avantage de l’assignation en référé- expertise introduite dans ce délai contre le constructeur susvisé par un autre constructeur de l’opération (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-17495).
Une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion décennale de l’action du maître d’ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-13305).
Responsabilités tous azimuts
Responsabilité du maître d’œuvre. Viole l’article 1147 (aujourd’hui 1231-1) du Code civil la cour d’appel qui rejette une demande d’indemnisation formée contre un architecte à raison d’un déficit de surface du bien construit, au motif que celui-ci n’avait reçu aucune mission complémentaire de mesurage des existants ou de calcul des superficies loi Carrez. En effet, énonce la Cour de cassation, un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux, est « tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces » (Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12315, Bull.).
Même lorsque les documents contractuels ne précisent pas que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision, et n’indiquent pas les contraintes constructives particulières – notamment celle relative à la surépaisseur de la dalle porteuse sur l’ensemble de sa surface de manière à pouvoir changer les machines de place au fil du temps -, il appartient au maître d’œuvre « de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu’il accepte de concevoir et diriger », et de « conseiller au maître d’ouvrage les aménagements adaptés à son projet » (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-11668).
Dans l’exécution de sa mission qui inclut la conception et l’établissement d’une demande de permis de construire, l’architecte doit proposer un projet réalisable et conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. Cette obligation contractuelle s’étend à la conception d’un bâtiment d’habitation respectant les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées et ce, indépendamment des difficultés d’interprétation des critères d’application de ces normes. Le non-respect de ces exigences entraîne la responsabilité de l’architecte, l’exposant à une condamnation à prendre en charge les coûts de démolition et de reconstruction nécessaires pour assurer la conformité du bâtiment (Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 21-21970).
Faute du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage qui rénove un bien qu’il a acquis en toute connaissance d’un diagnostic parasitaire mentionnant des infestations de champignons, et revend le bien en appartements après l’avoir divisé et avoir confié à un diagnostiqueur la réalisation des états parasitaires ne révélant aucune infestation, se voit retenir une faute constitutive d’une acceptation des risques qui l’empêche d’être garanti intégralement des travaux de réparations nécessaires à la suite d’un affaissement du plancher, mais seulement de 50 % de leur montant (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12217).
De même, le maître d’ouvrage qui fait construire en Vefa une maison et prend le risque délibéré de ne pas faire réaliser d’étude de sol avant la réalisation des travaux, malgré l’avis défavorable du contrôleur technique, a commis une faute. Celle-ci justifie que son assureur ne soit garanti par les assureurs des constructeurs qu’à hauteur de la moitié des dommages (Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 22-22794).
Recours entre constructeurs. Les recours croisés du maître d’œuvre et de l’entrepreneur quant aux conséquences des désordres résultant du sous-dimensionnement de la ligne de production d’une scierie sont accueillis à hauteur de leur faute respective et du lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-12535).
La recevabilité des recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne dépendant pas de celle de l’action en responsabilité décennale du maître d’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage à leur encontre, lesdits constructeurs justifient d’un motif légitime pour déclarer les opérations d’expertise opposables à leurs assureurs, même à une date où ils ne seraient plus exposés aux recours du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-11746, Bull.).
Tandis que le maître d’ouvrage a dix ans pour agir à l’encontre des constructeurs à compter de la réception des travaux, les constructeurs exercent leur recours entre eux dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ est la demande de reconnaissance d’un droit. Il en résulte que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à un constructeur ne peut plus servir de point de départ aux recours récursoires des constructeurs, sauf si elle était accompagnée d’une demande en réparation, ne serait-ce que par provision (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12449 ; Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-15701).
Fabricant. Le délai de prescription quinquennale de l’action contractuelle directe du maître d’ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur responsable de la fourniture et de la pose, lequel est pour sa part tenu d’une responsabilité décennale à compter de la réception (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 22-22792).
Garantie des vices et non-conformité. « L’action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 [portant réforme de la prescription en matière civile], si le délai de prescription décennal antérieur de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui enserrait le délai d’un an, n’était pas expiré à cette date », énonce la Cour (Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-15925, Bull.) Au double visa des articles 1648 et 2239 du Code civil, la Haute juridiction souligne que le délai biennal de la garantie des vices cachés est un délai de prescription (et non pas un délai de forclusion insusceptible de suspension), de sorte que l’expertise judiciaire avait bien eu un effet suspensif du délai de ladite garantie (Cass. 1re civ., 4 septembre 2024, n° 23-14650).
En l’absence de désordres affectant l’étanchéité des deux salles de bains d’une maison individuelle, le non-respect de normes (DTU 52.2), du cahier CSTB et de la fiche technique du produit, qui ne sont obligatoires ni par la loi ni par le contrat, n’entraîne pas d’obligation de mise en conformité à la charge du constructeur (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-15363).
L’acquéreur en Vefa dispose d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration d’un mois après la prise de possession des lieux pour exercer contre le vendeur l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même si ceux-ci sont dénoncés après l’écoulement de ce délai d’un mois (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-15678).
Réparation. Le maître d’ouvrage qui perçoit une indemnité permettant d’effectuer des travaux de réparation ne peut solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance né du fait qu’il n’a pas affecté ladite indemnité à la réalisation de tels travaux (Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 22-14088, Bull.).
La Cour a fait application, dans le cadre de la mise en jeu de la garantie décennale, du principe de la réparation intégrale, qui suppose l’indemnisation du préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le bénéficiaire. Ainsi, les acquéreurs d’une maison individuelle qui ont bénéficié d’une réduction du prix de vente des premiers acquéreurs, en considération des désordres de gravité décennale affectant la maison vendue, et ont donc déjà été indemnisés, au moins partiellement, de leur préjudice matériel, ne peuvent réclamer au vendeur que la différence entre le préjudice retenu par l’expert et la réduction de prix consentie (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 20-16712).
Troubles anormaux de voisinage. La personne qui subit un trouble anormal de voisinage – en l’espèce, une nuisance sonore – a droit à réparation, quand bien même celui-ci aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-20880).
« Si les jours de souffrance n’entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, dès lors que celui qui s’en prévaut démontre que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage », a tranché la Cour. En l’espèce, l’un des murs de l’immeuble construit était accolé au mur pignon du bâtiment, ce qui avait pour effet de murer totalement les deux jours perçant ce pignon, empêchant tout passage de lumière et toute possibilité d’aération des locaux à usage professionnel loués (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-11448).
En revanche, lorsque plusieurs immeubles d’habitation collective, similaires à celui édifié par le maître d’ouvrage assigné, sont déjà implantés dans le secteur, le voisin peut normalement s’attendre à la modification de sa vue. Celle-ci ne caractérise donc pas un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 26 septembre 2024, n° 23-13770).
La sous-traitance
Il résulte de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que « si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. Le maître d’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une telle inopposabilité qu’à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti » (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11682, Bull.).
Marchés de travaux
DGD. Les comptes de fin de chantier doivent être établis selon des clauses contractuelles précises. Lorsque le contrat prévoit, par exemple en référence à la norme NF P 03-001 (CCAG des marchés privés de travaux), que le maître d’ouvrage doit notifier un décompte définitif dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif de l’entrepreneur, le silence du maître d’ouvrage à l’expiration de ce délai vaut acceptation irréfragable du mémoire, qui devient définitif et lie les parties. Il en est de même si le maître d’ouvrage se borne à indiquer par courrier qu’il refuse d’examiner le mémoire eu égard aux malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-13790).
Cotraitance. En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître d’ouvrage, pour représenter les autres membres d’un groupement d’entreprises, « n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché » (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-21831, Bull.).
Garantie de paiement. La garantie de paiement due par le maître d’ouvrage à l’entreprise pour garantir le prix de son marché peut, en application de l’article 1799-1 du Code civil, être exigée à tout moment pendant l’exécution des travaux, et même après achèvement de l’ouvrage si le solde n’est toujours pas réglé. La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître d’ouvrage ne le dispense pas de garantir le prix (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-10727).
Assurances
Activités déclarées. Lorsque, sur les cinq désordres de type décennal, seuls trois étaient couverts par la garantie d’assurance au titre des activités déclarées, alors que la solution retenue pour reprendre les cinq désordres consistait à démolir et reconstruire la villa, l’indemnité n’est toutefois pas limitée à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à seulement un tiers dudit coût – comme l’avaient décidé les juges d’appel -, puisque les désordres couverts par l’assurance justifiaient à eux seuls cette solution réparatoire. L’assureur doit donc garantir l’intégralité des travaux de remise en état dès lors que les désordres couverts par la garantie contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-10461).
Dol. La faute intentionnelle est distincte de la faute dolosive. La première implique la volonté directe de causer le dommage tel qu’il est survenu, tandis que la seconde se caractérise par une prise de risque consciente, rendant inéluctable la réalisation du dommage, sans nécessairement que l’auteur ait voulu le résultat précis. Lorsqu’un promoteur, informé par un expert de la nécessité de travaux de rehaussement, choisit délibérément de livrer l’immeuble sans les réaliser, les juges saisis sont ainsi fondés à qualifier cette action de faute dolosive, en dépit de la connaissance du caractère inévitable du dommage (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-15803).
Autorité. « Attachée au seul dispositif de la décision, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice », rappelle la Cour de cassation. Dès lors doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui retient l’autorité de la chose jugée d’une décision de 2015 ayant rejeté la demande d’indemnisation d’un maître d’ouvrage contre l’assureur au titre de la responsabilité décennale, après avoir constaté que la créance indemnitaire du maître d’ouvrage était née de la décision d’un tribunal administratif en 2017 l’ayant définitivement fixée à l’égard du constructeur assuré, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s’est réalisé, et caractérisait l’existence d’un fait nouveau justifiant d’écarter l’autorité de la chose jugée antérieurement par le juge judiciaire (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-17351, Bull.).
Exclusion. Pour être valables, les clauses d’exclusion des polices d’assurance doivent être formelles et limitées, en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Tel n’est pas le cas de la clause d’une police de responsabilité civile souscrite pour les dommages survenant avant réception excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », dès lors qu’elle est susceptible d’interprétation (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-12129).